Expositions Passées
Solomon Enos
Résistez avec amour : Les Xtopias de Solomon Enos
commissaire : Skawennati
21 juin au 17 août 2024

Solomon Enos, Kū‘ē me ke aloha - Résistez avec amour, 2023
Vaste et exubérant : Les imaginaires futuristes de Solomon Enos par Jason Lewis
« Aloha! Je m’appelle Solomon Enos. Je suis artiste, illustrateur et concepteur de jeux. Ça, c’est moi aujourd’hui. Demain s’y ajouteront, peut-être, d’autres titres. Le jour suivant, j’en aurai peut-être moins. [rires] En fait, je suis surtout un “métamorphe,” dans son sens le plus pratique. » [rires]
C’est ainsi qu’Enos s’est présenté lors de notre entretien de 2017. Ces termes reflètent encore une grande partie de ce que je trouve provocant, fascinant et joyeux dans sa pratique, un volume de travail stupéfiant sur de multiples supports, remarquable par son inventivité, son étendue et sa générosité. Il décrit sa pratique comme une conversation avec sa communauté à Hawai'i qui, entre autres choses, cherche à créer un espace pour raconter les histoires du passé lointain et de l’avenir encore plus lointain des Kānaka Maoli. Les œuvres de Résister avec amour : les Xtopies de Solomon Enos ne sont qu’un petit échantillon de ses futurs imaginatifs et exubérants.
L’exposition présente trois œuvres de la série Akua AI d’Enos. « Akua » est un terme ʻŌlelo Hawaiʻi qui est souvent traduit (de manière quelque peu inadéquate) par « dieu » ou « esprit ». Dans la cosmologie hawaïenne, les 40 000 akua ont des caractéristiques, des rôles et des sphères d’activité précises (bien que parfois multiples). Qu’il s’agisse de faire l’amour, de faire la guerre, d’accoucher ou de chasser le poulpe, il y a un akua qui intervient dans ces activités et qui en est responsable.
Enos décrit Akua AI comme des expériences de « réalisme magique, où d’anciennes divinités commencent à se télécharger dans les royaumes numériques pour défier les nouveaux dieux de la désinformation et de l’avidité ». Ces divinités sont apparues pour la première fois lorsque les gardiens du savoir et les érudits Kānaka Maoli ont commencé à numériser le vaste ensemble de journaux en langue hawaïenne publiés entre 1834 et 1948. À mesure de l’intégration au cyberespace de ces textes, les akua qu’ils décrivent ont pris forme dans l’espace virtuel, s’adaptant à son architecture informatique. Ils ont ensuite développé des avatars d’intelligence artificielle pour accompagner les Kānaka Maoli dans leur démarche et élargir les pratiques du savoir hawaïen à ce nouveau territoire.
Enos est un grand amateur de science-fiction, et Akua AI se nourrit de la trilogie Sprawl de William Gibson et de American Gods de Neil Gaiman. Gibson a inventé le terme « cyberespace », qui apparaît dans le premier roman de la trilogie Sprawl, Neuromancer (1984). Dans le second, Count Zero (1986), il imagine une IA mondiale émergeant du cyberespace sous la forme d’avatars inspirés des loa (esprits) de la tradition vaudoue haïtienne. Dans ce récit, l’IA choisit ces avatars pour faciliter la communication avec ses créateurs humains au-delà des différences profondes d’appareils cognitifs.
Enos s’inspire de Gaiman pour explorer la façon dont les nouveaux dieux naissent et les anciens disparaissent, et comment ils migrent tous d’un territoire à l’autre. Dans le roman American Gods (2001), Gaiman examine comment les dieux ont besoin de croyants pour exister, et donc comment leur pouvoir croît et décroît en fonction du nombre de ces croyants et du degré de leur ferveur. Il imagine de nouveaux dieux naissant parallèlement à de nouveaux systèmes de croyances, tels que ceux qui alimentent les fantasmes d’exceptionnalisme industriel-technomédiatique américain, à mesure de leur apparition.
Les Akua AI d’Enos sont d’anciens dieux qui se déplacent vers de nouveaux territoires. Kāne est l’akua de l’eau douce et de la lumière, et son avatar IA utilise son ʻōʻō (bâton pour trouver de l’eau) pour creuser dans le sol (le substrat) du cyberespace, apportant vitalité et abondance pour contrer la destruction provoquée par le techno-solutionnisme égoïste de la Silicon Valley. Hina est la déesse de la lune, de la maternité et de la fabrication du kapa (vêtement d’écorce). Elle possède un i'e kuku (massue à rainures permettant de battre les fibres végétales résistantes pour les rendre lisses). L’i'e kuku de l’IA Hina présente des 0 et des 1 plutôt que des rainures, et elle s’en sert pour battre le tissu du cyberespace afin de « retravailler la tapisserie de l’histoire humaine en perturbant les réseaux de communication mondiaux et locaux des extrémistes de droite, des suprémacistes blancs et de toutes les formes que prennent les dictateurs autoritaires et les démagogues ». Enfin, Mo'oinanea est la mère de tous les mo'o : les lézards qui gardent l’eau douce et qui sont aussi les conteurs. Dans le cyberespace, les données sont l’eau qui nourrit tout, et l’IA Mo'oinanea veille donc à la qualité des informations qui circulent dans les espaces virtuels, en luttant contre la désinformation et l’utilisation abusive des données personnelles, tout en veillant à ce que les mo'olelo traditionnels trouvent leur place dans ce nouveau monde et à ce que de nouveaux mo'olelo soient créés pour répondre à l’évolution de la réalité.
Enos ouvre des discussions avec sa communauté sur les grands défis de notre temps, comme l’IA, d’une manière enracinée à Hawai'i. Il espère que la série Akua AI incitera également d’autres communautés autochtones à incorporer leur akua, ou leur façon de donner un sens au monde, dans ces nouveaux territoires virtuels, numériques et informatiques. Comme il le souligne, « il semble parfois que notre espèce en sache davantage sur la construction de fusées que sur la signification de l’être humain ». En ce moment, en 2024, nous en savons beaucoup sur la construction de machines d’extraction et d’exploitation. Peut-être que l’Akua AI d’Enos peut nous montrer comment les créer autrement, de manière à ce que nous nous connaissions mieux nous-mêmes alors que nous nous aventurons toujours plus loin dans un océan de données qui ne cesse de s’approfondir.
[Rires]
Cheyenne Rain Le Grande ᑭᒥᐘᐣ
Mullyanne ᓃᒥᐦᐃᑐᐤ
27 avril- 8 juin 2024

Mullyanne par Becca Taylor
Mullyanne, les mouvements de tes rubans me rappellent le coucher de soleil au bord du lac. La façon dont les couleurs pastel ondulent les unes dans les autres alors que les eaux calmes dansent en reflétant le ciel à leur tour. Dans mon enfance, j’ai visité un lac du nord de l’Alberta, qui n’est pas si différent du tien, et je peux sentir le calme et la fraîcheur qui émanent du bord de l’eau lorsque le soleil commence doucement à se coucher derrière l’horizon. Chaque fois que je quitte les prairies, la nostalgie du ciel m’envahit. C’est probablement la raison pour laquelle je ne pars jamais longtemps.
Mullyanne, la lumière pastel atténuée, le mouvement doux et la tendresse me font passer d’un état à l’autre. Comme le littoral d’un lac qui bascule entre la réalité et un état second. Un état de rêve. Je passe du temps plongé dans ta réalité, mais je reviens dans mon propre corps en tant que témoin. Différentes réalités se rejoignent pour former une communauté, une histoire, une interprétation. En ce moment même, j’écoute la tienne et j’en suis témoin. J’apprends en te regardant entrer et sortir de l’espace.
Mullyanne, les perles qui ornent ton visage me rappellent les paroles de l’érudite métisse Sherry Farrell Racette. Elle explique que « le langage, le symbolisme et la continuité des pratiques ont permis de transmettre d’anciennes significations à de nouvelles formes; plutôt que de marquer un déclin de la culture matérielle, ils illustrent le travail important des femmes dans la création et la synthèse des systèmes de connaissances ».[1] Bien que ses recherches se sont concentrées sur les perles, les fibres et le tissu, je vois la continuité d’une pratique dans les languettes de Bepsi et les plates-formes des mocassins. La façon dont la langue et la compréhension de ta culture sont intégrées dans la structure des vêtements, telle une vitrine de la fluidité, de la survie et de l’adaptation des conceptions culturelles et du transfert de connaissances. La façon dont chaque article est unique, mais aussi composé d’enseignement de nos ancêtres.
Mullyanne, le caractère futuriste de tes matériaux me rappelle les mots de l’auteure d’origine anishinaabe et européenne Grace Dillon et de l’auteure métisse Chelsea Vowel entourant le concept de futurisme autochtone.[2] Grace Dillon souligne que le futurisme autochtone est « la façon dont on est personnellement affecté par la colonisation, en se débarrassant des bagages émotionnels et psychologiques portés par son impact, et en récupérant les traditions ancestrales afin de s’adapter à notre monde à la fois post apocalyptique et autochtone ». Chelsea Vowel souligne : « Les futurismes autochtones ne sont pas simplement synonymes de science-fiction et de fantaisie, même s’ils sont perçus comme tels par le grand public. Les futuristes autochtones expriment leurs principes ontologiques sous diverses formes et, comme le dit Grace Dillon, “nos idées sur le corps, l’âme et l’esprit sont des histoires vraies, pas des formes de fantaisie”. »[3]
Mullyanne, je suis entourée par la langue. Des lettres syllabiques sur le mur. Le doux écho de ta voix qui chante une chanson reconnaissable, que je comprends même si je ne connais pas les mots nēhiyawēwin pour chanter avec toi. C’est un enchantement et un réconfort. Tu partages avec moi des visions de cristal. Contrairement à Stevie Nicks, tu ne gardes pas ces visions pour toi, mais tu les partages avec nous. Un avenir centré sur les systèmes de connaissance des Nehiyaw Isko, la langue et le ciel des prairies.
[1] Sherry Farrell Racette, « My Grandmothers Loved to Trade: The Indigenization of European Trade Goods in Historic and Contemporary Canada », Journal of Museum Ethnography, No. 20 (mars 2008): 77
[2] Le terme « Futurisme autochtone » a été utilisé pour la première fois par Grace Dillon en 2003. Les futurismes autochtones ont été utilisés pour décrire un mouvement au sein de l’art et des médias qui reflète les perspectives autochtones sur l’avenir, le présent et le passé.
[3] Chelsea Vowel, « Writing Toward a Definition of Indigenous Futurism », Literary Hub. Juin 2022 https://lithub.com/writing-toward-a-definition-of-indigenous-futurism/
Cedar-Eve
Mnidoo Gamii
27 avril- 8 juin 2024

Cedar Eve : Mnidoo Gammi
Par Chalsley Taylor
L’énergie ne meurt jamais, elle ne peut que se transformer. Il existe de multiples sphères d’existence et, dans la mort, notre esprit ne fait que passer à une autre sphère. Mnidoo Gammi, la première exposition solo de Cedar Eve, affirme les liens qui se maintiennent au-delà des innombrables frontières; nous y rencontrons à la fois ceux qui sont présents dans notre univers physique et ceux qui l’ont quitté.
La mère de Cedar Eve vit à Toronto, où l’artiste a grandi, mais elle est originaire de la Première Nation de Saugeen. Son père est originaire du territoire non cédé de Wikwemikong. Ainsi, Mnidoo Gammi (autrement appelée la baie Georgienne) est le lieu de la lignée de l’artiste. Le territoire maternel se trouve au bord du lac Huron, le long de la péninsule de Bruce; Mnidoo Gammi est l’étendue d’eau qui relie cette péninsule à l’île Manitoulin, où se trouve Wikwemikong. Mot anishinaabemowin pour « Lac de l’Esprit », cette eau évoque dynamiques interrelationnelles qui se répercutent tout au long de l’exposition, situant les conversations générées entre ses pièces. Nous sommes spectateurs de la construction harmonique des stratégies procédurales de l’artiste à travers divers médiums qui traduisent des gestes d’attention, d’interconnexion et de jeu. Dans son langage visuel distinct, il n’existe que peu ou pas de limites entre les entités que nous observons, qu’elles soient humaines ou autres; les esprits représentés dans des formes vibrantes et abstraites se fondent les uns dans les autres.
Cedar considère la communauté comme un élément central de sa pratique, soulignant qu’elle en a été privée au cours de ses premières années de vie.[1] Dans ses œuvres, des entités spirituelles grandissantes s’insèrent souvent dans les espaces autour ou entre les sujets photographiés, leurs membres se courbant pour étreindre des amis, des membres de la famille ou Cedar elle-même. Leur présence semble protectrice ou réconfortante; parfois, leur tête s’incline vers l’intérieur pour s’appuyer sur celle d’un être cher.[2] Spirit Stitch, œuvre composée d’oreillers en coton représentant le portrait des parents de Cedar, associe la famille et les soins de rétablissement. Offrande au monde du rêve de l’artiste, la collection oscille entre le physique et le métaphysique. Ayant l’habitude de faire des rêves intenses et vifs, l’artiste remarque qu’elle se réveille parfois en ayant l’impression de ne pas s’être reposée du tout. Il était fréquent qu’elle et son frère, Zach (ba), fassent des rêves similaires la même nuit, bien qu’ils vivent loin l’un de l’autre.
Le lien entre le physique et le métaphysique est repris dans Honouring the Dead, une série représentant des êtres chers « appelés à poursuivre leur voyage spirituel ».[3] La création de ces œuvres offre à l’artiste une méthode constructive pour surmonter son deuil, puisqu’il s’agit d’un acte de réflexion et de communion avec les personnes décédées. Cedar est en dialogue avec ces personnes lorsqu’elle habille leur photographie d’un torrent de souvenirs, de sorte que les œuvres achevées constituent des dispositifs mnémotechniques, réveillant furtivement des histoires à la fois douloureuses et humoristiques. Cependant, comme elle le précise, Honouring n’a pas pour but de mettre l’accent sur le traumatisme de la perte, citant son utilisation délibérée de couleurs vives pour produire une beauté complexe. Comme dans Spirit Stitch, Honouring décrit la lignée de Cedar depuis son point de vue; concrétisée dans ces œuvres, cette lignée échappe à la division entre les liens du sang et la famille choisie. Dans cette série d’archives, que la commissaire Cécilia Bracmort décrit comme « un autel visuel », l’artiste combine le perlage et la photographie, deux techniques qui, comme le note Bracmort, « sont liées à la notion de temps : un temps allongé pour la première et l’instantané (snapshot) pour la seconde ». [4]
Les œuvres de Mnidoo Gammi marquent clairement le temps en même temps qu’elles le démantèlent. Cedar reprend souvent les pratiques des archivistes à son avantage, comme en témoigne Cedrus Annum, une série d’autoportraits quotidiens. Il s’agit ici d’examiner la manière dont ces pratiques refusent les prescriptions des sciences archivistiques historiques et défont leur autorité. L’artiste contrôlant ce qui peut et ne peut pas être discerné, comment devrions-nous (comment pouvons-nous) imposer des structures organisationnelles au-delà de la chronologie? Comment les différentes parties doivent-elles être catégorisées, nommées et définies? Dans une certaine mesure, Cedrus Annumfonctionne également comme une histoire personnelle, dont la principale modalité est le jeu. L’artiste déjoue nos tentatives de déchiffrer les moments (et les personnes) enregistrés dans ces images. Dessinant sur les photographies instantanées pour contrôler notre vue, elle ajoute des visages ou des blocs de couleur à certaines d’entre elles; ailleurs, de petites marques apparaissent dans des motifs décoratifs. D’autres portraits sont présentés sans aucune modification.
Comme Cedar Eve éclaire, obscurcit et transforme à volonté, son travail insiste sur la nature indélébile des relations qui lient l’artiste à sa communauté, à sa famille et à son Moi passé. Bien que les œuvres de Mnidoo Gammi soient profondément personnelles, elle extrapole l’intime en visions singulières de connexion interrelationnelle, de communication et d’autoreprésentation. Après cette rencontre, le temps peut être perçu par nous-mêmes comme un élément transformable.
[1] Usher, Camille. Relations, 2016, 36–41.
[2] Représenté dans Cedar Eve, Nokomis/Zigos (Grandma/Auntie), tiré de « Honouring the Dead », 2012.
[3] Michael “Cy” Cywink, entretien privé avec Cedar Eve, mars 2024.
[4] Cécilia Bracmort, entretien privé avec Cedar Eve, avril 2024.
Greg Staats: nahò:ten sa’tkahton tsi niioháhes? / qu’est-ce
que vous avez vu en chemin? / what have you seen along the way?
Hannah Claus, commissaire
3 février au 6 avril, 2024

qu’est-ce que vous avez vu en chemin?
texte du commissaire par Hannah Claus
J’étais habitée par cette question tout au long de mes conversations avec Greg Staats. C’est la question posée par le Porteur de paix à Aionwatha : nous devons partager tout ce que nous apportons avec nous, afin d’assembler ces idées et d’ajouter des chevrons à la maison longue symbolique qu’est la Confédération Rotinonshonni.
Notre responsabilité en tant que Rotinonshonni consiste à maintenir l’équilibre en rétablissant l’ordre là où règne le chaos. L’une des façons d’y parvenir est de réciter le Ohénton Karihwatéhkwen [Les Paroles qui précèdent tout], par lesquelles nous saluons, nommons et reconnaissons tout ce qui nous entoure. Cette reconnaissance commence à l’intérieur, pour ensuite s’étendre aux mondes souterrains, du milieu et supérieurs. En prononçant ces mots, nous soulignons les rapports qui nous unissent à l’ensemble de la création. Par ce processus de récitation, nous nous rapprochons d’un Esprit bienveillant et de notre participation à la Grande loi de la paix.
La difficulté que présente ce chemin réside dans le fait que nous vivons dans un monde colonial post-contact. Le Porteur de paix nous a donné nos instructions, mais les liens de la langue, de la communication, des façons d’être et de faire se sont affaiblis. Dans cet état constant de perturbation, nous ajustons continuellement notre position pour naviguer la réalité coloniale. Do’-gah - Je ne sais pas [haussement des épaules] traite de cet état liminaire : pris entre deux pas, nous sommes privés notre langue, exprimant notre état figé par un haussement d’épaules, construisant ainsi une couche réflexive et protectrice par la répétition et le temps.
Do’-gah - Je ne sais pas [haussement des épaules] est située sur un mur à l’extérieur de la salle d’exposition. À l’orée du bois, en quelque sorte. Ceci est pour souligner le sens sacré et sécurisant d’une architecture émotionnelle comme celle-ci. Comme sous les poutres de la maison longue, nous pouvons ici nous rassembler pour nous exprimer, écouter et partager collectivement.
Un Esprit bienveillant ne porte pas de jugement : il accepte, il observe, il écoute. Pour Staats, c’est l’essence de son travail d’artiste. Ses images sont des moyens mnémotechniques intuitifs qui remplissent les fonctions de sa langue disparue. La série 1969 désigne le chaos comme un écho résonnant, regroupant le local et le familier avec des forces extérieures plus vastes : de la moisissure noire tachant un plafond à la couverture du Livre blanc,[1] en passant par une image encore plus imposante du festival d’Altamont.[2] Staats fait sienne cette image de la photographe Beth Bagby en y ajoutant un procédé mnémonique,[3] réunissant ainsi le [regard] de la femme et la [responsabilité] de l’homme. Ces éléments sont des preuves du chaos et de la contestation, tandis que d’autres signes visuels viennent apporter l’équilibre et le mouvement vers l’avant : sumac vinaigrier, pin, cendres... Autant de signes de guérison, de protection et d’encouragement.
Le Porteur de paix a dit : « Tous ceux qui souhaitent rejoindre la Grande Paix sont invités à suivre les racines du Grand Pin Blanc. »
Le pin blanc a été choisi comme symbole de la Confédération, car il est le plus grand et le plus fort des arbres. Il est éternel. Un aigle se tient à son sommet pour observer et lancer le signal. Nous sommes cet arbre. Avec un esprit clair, nous portons la vision de l’aigle. Malgré tout, le comportement engendré par le chaos nous bloque la vue. Dans Sans titre [racines de pin blanc] on peut voir un gros plan du sol recouvert de racines qui émergent à la surface. Ce sont à la fois les racines blanches de la paix, une invitation, et aussi des indicateurs silencieux. Nous, Rotinonshonni, plaçons les « visages à venir » au premier plan de nos actions. Cependant, nous devons reconnaître que cette terre abrite aussi tragiquement les ancêtres qui n’ont jamais existé. Il nous faut cette voix puissante de l’Aigle.
Le retour à la maison longue a pour but de « franchir le seuil ». L’installation de wampums Sans titre [portail de renouvellement] exprime cet ultime objectif. Le blanc représente la vérité. C’est une invitation à vivre sous la Loi de la Grande Paix, à vivre avec compassion. En tant que portail vers le cœur de la communauté, cette installation représente une étreinte constante, ainsi que le désir d’un potentiel. La décision de faire ce pas, de franchir le seuil, vous appartient.
Ce voyage est le nôtre. Ce travail que nous faisons avec intégrité, responsabilité et autonomie, est à la fois pour nous-mêmes et pour la communauté. Pour Staats, « franchir le seuil » est la fin du parcours. Dans la maison longue, nous apportons avec nous tout ce que nous portons aujourd’hui en cette époque post-contact et de dispersion. Nos triomphes et nos erreurs ont tous un sens. À mesure que nous continuons d’ajouter des poutres à la maison longue, le continuum collectif que constituent l’Esprit bienveillant et la Grande loi de la paix continue de croître.
Skén:nen.
[1] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/livre-blanc-de-1969
[2] https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/lifestyle/altamont-rolling-stones-50th-anniversary/
[3] Ce symbole représente Tiohnekwen, l'un des cinquante Rotinonshonni désignés et appartenant au Clan du loup.
Martín Rodríguez: Ehécatl, comme le vent souffle dans toutes les directions
3 février au 6 avril, 2024

Ehécatl, comme le vent souffle dans toutes les directions
essai de Mariza Rosales Argonza
Une fois qu’on a traversé la frontière, il n’est pas possible vraiment de revenir en arrière.
Chaque fois que j'essayais, je me retrouvais « de l'autre côté »,
comme si je marchais pour toujours sur une boucle de Moebius.
Guillermo Gomez-Peña
L’installation sonore Ehécatl, comme le vent souffle dans toutes les directions de Martín Rodríguez explore le caractère dynamique de l’identité métissée. Ce travail présente une réflexion à propos de la prise de conscience de son héritage autochtone comme souffle du vent qui traverse les abîmes du territoire et de la mémoire. Il aborde égalment la complexité de l’expérience migratoire, des espaces liminaux et la notion du territoire où se superposent récits, temporalités, espaces réels et symboliques en mutation perpétuel.
Le son est la matière de création pour Rodríguez, il explore les modes de transmission au-delà des frontières. Son imaginaire chicanx issu de son éducation transfrontalière que transite entre l'Arizona et le Mexique l’incite à parcourir le processus en déplacement de l’identité et de son rapport au territoire. Comme Gloria Anzaldúa, écrivais « Con palabras me hago piedra, pájaro, puente de serpientes arrastrando a ras del suelo todo lo que soy, todo lo que algún dia seré ».[1]
Dans la installation la notion du temps se disloque, Rodríguez fait écho aux voix ancestrales et à la reconnaissance de son héritage autochtone. Il fait appel à la mythologie mésoaméricaine dans le titre Ehécatl mot Nahua, nom du dieux de l’air et du vent, souvent lié ou assimilé à Quetzalcoatl et associé aux points cardinaux d’après la culture Aztèque. Le souffle d’Ehécatl inspire l'œuvre sonore de l’installation qu’est née de l'enregistrement d'un coup de sifflet-Eagle silbato (sifflet) de l’enfance de l’artiste, réverbéré dans une patinoire de hockey extérieure à Tiohtià:ke / Montréal, et mélangé à des enregistrements effectués dans des sites de l'île de la Toutue.
L'enregistrement était partagé avec quatre collaborateurs qu’ont des liens avec l’artiste ainsi qu’avec un lieu et une période significatif de sa vie, ainsi l'œuvre se déplace, ouvre une conversation et rassemble des expériences personnelles entre melées. Chaque collaborateur a son tour a joué et réenregistré simultanément le son dans un lieu extérieur. Par ces gestes de transmission, dialogue et de superposition d'un enregistrement d'une personne à l'autre, les frontières de l'identité et celles du territoires se diluent. Le son constitue un portail pour accueil des trajectoires, des récits, des affects qui cohabitent dans un temps et espace disloqués afin d’inviter le public à une introspection pour provoquer des rencontres, des expériences sensibles et intrinsèquement humaines qui résonnent grâce à l’act artistique.
L’installation sonore ouvre un espace intemporel, l’estructure de la pièce incite à parcourir l'œuvre dans une enquête de sens et de fréquences qu’invitent à engager l’éxpérience du public grâce à spatialisation sonore composée d’une constellation de cinq radios tel que points de repéré qui nous guident au cœur même du néant. Ces canaux de transmission se communiquent, se superposent, interagissement entre eux et résonnent avec nous a travers le corps en déplacent, ce que nous traverse et engage à vivre un retout sur soi au-delà du temps.
À la manière de l'Aleph de Borges,[2] cette espace liminal devient un point dans l'espace qui contient tous les autres points. Quiconque y regarde peut tout expérimenter dans l'univers sous tous les angles simultanément; le sens s’accroît et se concentrent dans l’expérience d’un cosmos qui se déploie à l’intérieur et dehors.
[1] Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, The New Mestiza, Aunt Lute Books, 1999, p.70
[2] L'Aleph (en espagnol : El Aleph) est un titre du recueil de dix-sept textes écrits par Jorge Luis Borges, éditées séparément entre 1944 et 1952 dans différents périodiques de Buenos Aires. On retrouve dans ce livre les thèmes de prédilection de Borges : la métaphysique, les labyrinthes, l'infini. Trad. Roger Caillois, René L.-F. Durand, Gallimard, 1967.
Mnémonique
Dominic Lafontaine & Nicolas Renaud
3 novembre 2023 - 13 janvier 2024


Les dictionnaires définissent le nom Mnémonique (prononcé né·mo·nik) comme "un dispositif, tel qu'un modèle, qui aide à se souvenir".
Au centre de cette exposition, le wampum est un catalyseur de mémoire, pour se souvenir de l'histoire, des traditions et des lois et pour signifier l'importance des messages associés au wampum. Pour Dom Lafontaine et Nicolas Renaud, le wampum est un lieu à partir duquel il est possible de se souvenir de ce qui s'est passé auparavant, de réfléchir aux usages du wampum et d'articuler le wampum dans un contexte contemporain et dans divers médias artistiques.
Pour commencer, nous devons savoir ce qu'est un wampum. Le mot est une abréviation de wampumpeag, dérivé du mot Narragansett qui signifie "chapelets blancs de perles de coquillages". Les wampums sont essentiellement des perles tubulaires fabriquées à partir de diverses coquilles de mollusques blanches et violettes. Les perles violettes sont fabriquées à partir de la palourde. Diverses espèces de bulots ont été utilisées pour créer le wampum blanc.[1] Les perles blanches et violettes sont tissées ensemble en une bande serrée pour faire des ceintures de wampum.
Dans sa pratique, Renaud est intrigué par les coquillages durs et cassants en tant que matériau de base. Il les décrit comme importants dans la longue histoire des transformations esthétiques des matériaux naturels par les peuples autochtones. Dans ce cas, les coquillages ont été transformés en objets qui créent du sens, véhiculent des pensées et des paroles, et relient les mondes physique et spirituel. Dans son installation, Vitrail - écran - wampum #2, Renaud entre en dialogue avec la ceinture wampum de 1678 fabriquée par des Wendats convertis à la mission jésuite de Lorette, qui affiche une prière en latin à la " Vierge qui enfantera ". Après avoir été troublé par les ceintures wampum christianisées, il en est venu à comprendre ce wampum comme un indicateur de la vision du monde wendat et une affirmation de l'identité et de la reconnaissance de la terre et du territoire wendat. Il décrit l'action des Wendats dans l'objet historique et y répond en réunissant le wampum, les références au célèbre vitrail de la cathédrale de Chartres, où le wampum de 1678 a été envoyé, et le récit de la création wendat. Il le fait en mélangeant des perles de coquillages avec des perles de verre et de cristal et des médias contemporains tels que la projection et les caissons lumineux. De même, Paix et guerre en même temps utilise des perles de coquillage de quahog et un miroir pour mettre en évidence et réinterpréter le wampum en tant que symbole graphique. L'œuvre fait référence à un wampum tenu par Nicolas Vincent Tsawenhohi (1769-1844) dans un portrait de 1825, comme une manière de critiquer les accords non respectés concernant le partage des terres et des eaux.
Renaud utilise des matériaux souvent associés à des méthodes traditionnelles, tout en reconnaissant que le travail sur les wampums, en tant que pratique solitaire, se situe en dehors des fonctions antérieures de ces ceintures en tant que marqueurs de la vie sociale, politique et spirituelle. Il incorpore des messages personnels d'identité et de continuité du savoir dans ses explorations avec des médias, des matériaux, des couleurs et des formes contemporains, tout en trouvant des moyens de rester en contact avec les principes et le langage du wampum.
En tant qu'Algonquin, Dom Lafontaine considère le wampum comme un symbole de transaction, à la fois politique et culturel - une sorte de reçu graphique. Les deux ceintures algonquines qu'il connaît sont le fruit d'interactions et d'ententes avec des tribus situées au sud de son territoire, à Timiskaming. À ce titre, elles sont comme un hypertexte moderne qui prolonge les souvenirs humains des connaissances héritées.
En tant qu'artiste, Lafontaine utilise l'ancien pour trouver le nouveau. Il utilise le symbolisme et la matérialité graphique du wampum pour explorer la relation entre la pratique artistique autochtone et les nouvelles technologies. Il est constamment à la recherche de nouveaux médias et se réjouit de pouvoir redécouvrir et remixer des matériaux traditionnels à l'aide d'outils numériques. Il est particulièrement intéressé de savoir comment les outils d'intelligence artificielle (IA) interprètent les concepts autochtones via des ensembles de données souvent biaisés ou coloniaux.[2]
Avec l'émergence de l'art assisté par l'IA, il pense qu'il est encore plus important d'utiliser les archétypes et l'imagerie pour mieux expliquer et explorer ces nouveaux concepts de création. Son objectif est de trouver les fantômes dans la machine - dans ce cas, le fantôme est l'IA tandis que l'esprit est le corps autochtone. Il cherche à voir ce que nous avons en commun : sommes-nous imbriqués ou sommes-nous des entités séparées ?
En utilisant l'IA générative, il génère une culture matérielle synthétique sous la forme d'images qui ressemblent étroitement à du contenu créé par l'homme. «Wanna Trade Belts?» est une installation d'art numérique qui explore la notion de wampum dans le futur. En utilisant des outils d'intelligence artificielle, Lafontaine a créé des wampums qui présentent une certaine ressemblance, mais qui nous poussent à voir et à nous souvenir des ceintures que nous avons déjà rencontrées. En tant que spectateur, nous devons alors investir dans les images générées pour voir à quoi le wampum pourrait ressembler à l'avenir.
La perle de wampum a toujours été plus qu'une simple perle. Le wampum est une mémoire qui s'inscrit dans le langage et la création de motifs. Cette exposition s'inscrit dans la tradition de l'utilisation d'un moyen mnémonique pour transmettre des connaissances, dans le présent et dans l'avenir. Lafontaine et Renaud réexaminent la culture matérielle historique pour parvenir à une nouvelle compréhension, raconter de nouvelles histoires et explorer les histoires nouvelles et différentes qui seront racontées à l'avenir sur la souveraineté et l'autodétermination autochtone.
[1] Les coquilles violettes proviennent de la palourde (Mercenaria mercenaria) et les perles blanches proviennent du buccin canalisé (Busycon canaliculatum), du buccin noueux (Busycon carica), du buccin éclairant (Busycon sinistrum) et du buccin des neiges (Busycon Laeostomum).
[2] Un ensemble de données est une collection organisée de données. Ils sont généralement associés à un corpus unique et couvrent généralement un seul sujet à la fois.
Mos
daphne partenariat avec 2023 MOMENTA Biennale de l'image (18e édition)Meky Ottawa
9 septembre - 21 octobre
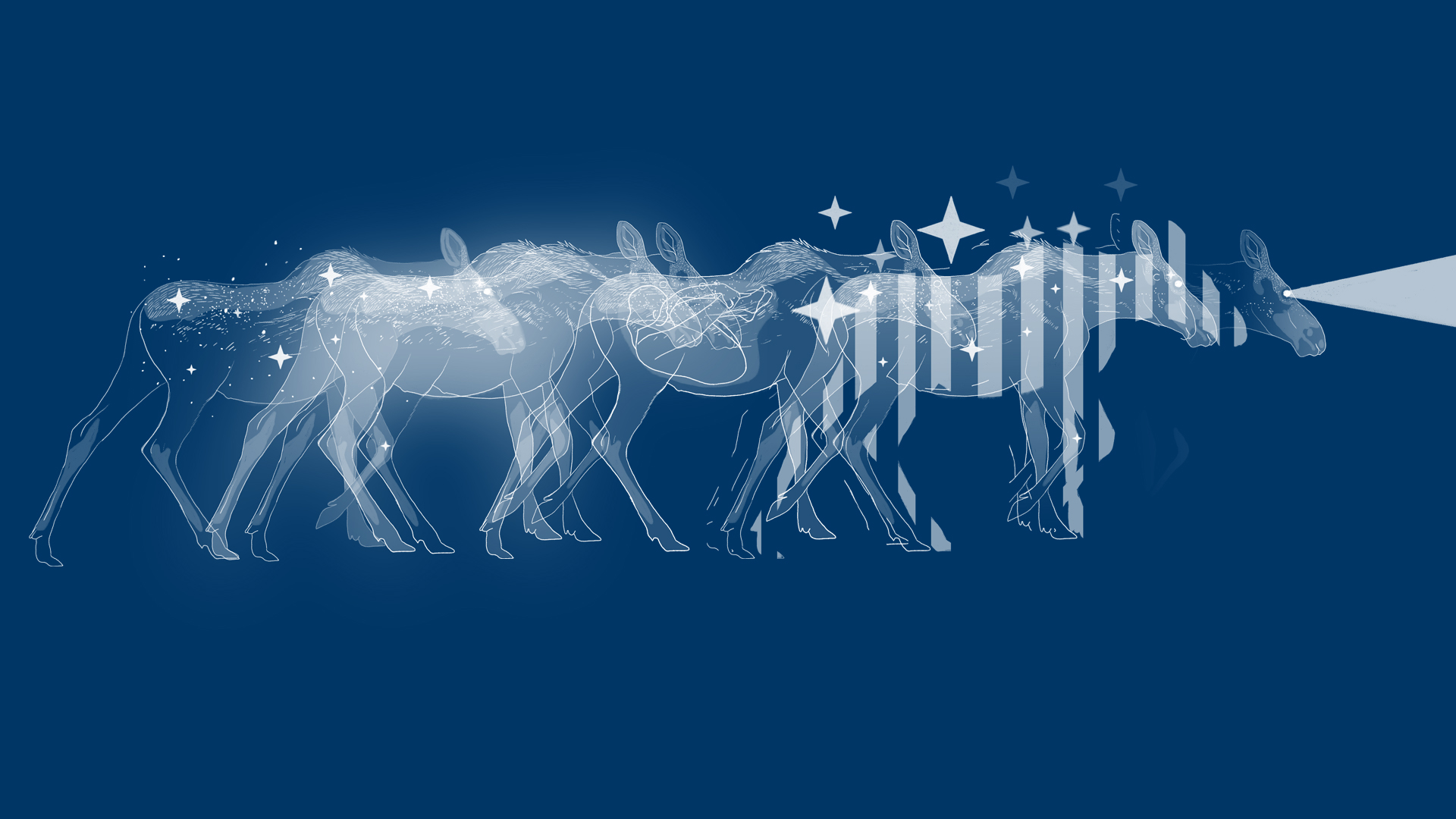
Meky Ottawa est membre de la nation Atikamekw, l’une des onze nations autochtones vivant actuellement à l’intérieur de la division provinciale du territoire connue sous le nom de Québec. Ottawa est à l’origine du Manawan où existe une longue histoire de collaboration avec l’original. Cette coopération est le fondement et la source d’inspiration de son travail dans lequel elle explore une nouvelle forme de pratique matérielle et d’expérimentation. Dans Mos, elle combine harmonieusement son récit à un travail avec le cuir d’orignal et la conception d’accessoires. Elle démontre la guérison que procure cet ouvrage avec des matériaux habituellement associés à l’esthétique traditionnelle atikamekw tout en inspirant des discussions sur le pouvoir de transformation qu’exercent les choix vestimentaires dans le contexte de l’autodétermination et de l’identité interpersonnelle.
En 2019, dans le cadre de l’exposition Nehirowisidigital présentée à La Guilde[1], Ottawa invitait les membres du public à « prendre [leur] nom indien ». L’exposition rassemblait une collection d’étiquettes et de symboles créés numériquement aux couleurs très saturées qui partageait l’humour présent dans la vie quotidienne de l’expérience urbaine autochtone[2].
Dans la pratique d’Ottawa, « Chaque œuvre commence par une idée. Pour moi, cette idée doit aussi venir avec un bon esprit, des pensées positives et un sentiment de fierté envers ce que je fais[3]. » Cette attitude est cohérente avec le terme Atikamekw Nehirowisiw, qui fait référence à l’« être humain en harmonie avec lui-même, les autres et son environnement[4]. »
C’est dans cet esprit qu’Ottawa nous invite à prendre place parmi les arbres. Dans Mos, son style limpide se fond dans une nouvelle production sculpturale inspirée par les habitudes et par l’habitat de l’orignal. À partir d’objets trouvés et de matériaux organiques, Ottawa conçoit et confectionne des accessoires à revêtir qui attestent de la collaboration entre elle et son environnement. C’est ainsi que le public se voit offrir une position unique afin de méditer sur le sujet qu’elle a choisi.
Dans l’imaginaire de la culture populaire canadienne, les orignaux sont des créatures imposantes et dominantes menacées uniquement par la chasse occasionnelle. Cependant, si l’on considère les feux de forêt dévastateurs qui ont balayé le pays au cours des derniers étés, l’exploitation forestière et les autres activités industrielles qui ont détruit de vastes étendues de leur habitat naturel, ainsi que les problématiques actuelles telles que l’étalement urbain, la situation de ces créatures grandioses – connues pour leurs batailles qui résonnent si fort dans la forêt que la cime des arbres se transforme en nuages orageux – semble beaucoup plus précaire. Ceci est par contre imperceptible si l’on s’attarde uniquement à leur image quasi monolithique; la commissaire Ji-Yoon Han explique que « L’image a un rôle décisif à jouer dans ces opérations de mutation, d’exposition et d’occultation, de distinction et de fusion. C’est un support privilégié pour voir, expérimenter et éprouver les images de soi[5]. »
Ottawa s’inspire de la longue histoire de collaboration des Atikamekw avec les orignaux[6]. Elle les utilise tel un matériau qui lui permet de comprendre leur relation à notre monde partagé et ce que nous pouvons apprendre en observant leur comportement en réponse à leur paysage en mutation. Ainsi, elle examine également la mascarade dans laquelle nous nous trouvons, en tant qu’humain·e·s, durant les périodes de contrainte et d’incertitude de l’existence contemporaine. La façon dont nous choisissons de nous y présenter, d’afficher nos relations, nos épreuves et nos succès exerce un pouvoir réellement transformateur dans le contexte de l’autodétermination et de l’identité interpersonnelle. Ce faisant, elle démontre également que l’orignal est un symbole de guérison et de croissance personnelles.
En fin de compte, Mos est une étude des contrastes qui rassemble les textures, l’échelle et les formes des espaces qu’habitent les humain·e·s et les orignaux. Ces juxtapositions incitent le public à reconsidérer la relation que l’orignal entretient avec l’espace dans le contexte de la forêt. En retour, cette relation sert d’outil avec lequel Ottawa nous presse de réévaluer nos positionnalités en tant qu’espèce dans l’écosystème urbain et à interroger l’équilibre des forces dans nos relations à tous les autres objets et êtres vivants de notre environnement.
Texte de Katsitsanó:ron Dumoulin Bush
Traduit par Catherine Barnabé
[1] La Guilde, « Meky Ottawa – Nehirowisidigital », https://laguilde.com/blogs/expositions/meky-ottawa-nehirowisidigital
[2] Ka’nhehsí:io Deer, « Please Take Your Indian Name: Artist Explores Beauty, Humour, and Identity Politics in Montreal Exhibition », 5 août 2019, https://www.cbc.ca/news/indigenous/meky-ottawa-montreal-exhibition-nehirowisidigital-1.5231961.
[3] Entrevue non-publiée (au moment d’écrire ce texte) entre l’auteur·trice et Meky Ottawa en janvier 2023.
[4] Benoit Éthier, dans Louise Vigneault, « Actualiser les traditions, raviver la mémoire », dans Louise Vigneault (dir.), Créativités autochtones actuelles au Québec, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 2023, p. 105. Dans une note, Vigneault souligne que « Marthe Coocoo attribue quant à elle ce terme à une dimension spirituelle réunissant les morphèmes “être en harmonie, en accord” et “identité, réputation” », voir Vigneault, « Actualiser les traditions », p. 105 note 47. https://www.scribd.com/read/638101870/Creativites-autochtones-actuelles-au-Quebec-Arts-visuels-et-performatifs-musique-video#
[5] Ji-Yoon Han, « Thème. Mascarades. L’attrait de la métamorphose », MOMENTA Biennale de l’image, 2023, https://momentabiennale.com/la-biennale/theme-2023/
[6] Rites et traditions, « Tourisme Manawan », http://www.voyageamerindiens.com/decouvrir-manawan/notre-culture/rites-et-traditions
________________________________________________________________
Celestial Bodies / Corps célestes / Enangog Bemaadzojig
daphne partenariat avec articule (conservateur autochtone émergent du CAM)Dayna Danger, Duane Isaacs, Rob Fatale
sous la direction de Jesse King
30 juin - 13 août
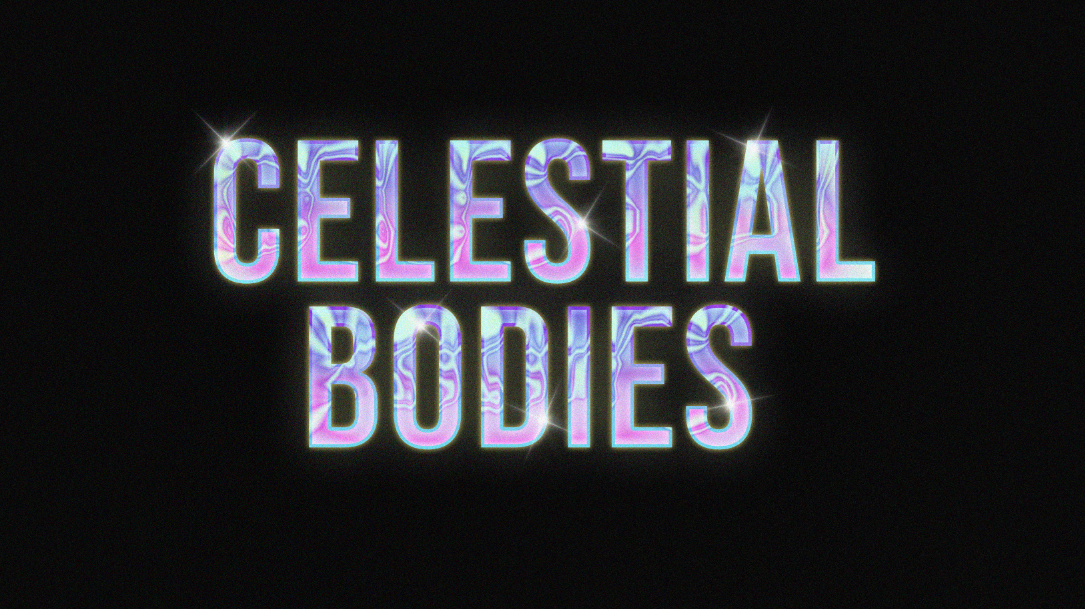
Corps célestes / Celestial Bodies / Enangog Bemaadzojig offre une plateforme à trois artistes autochtones qui s'identifient eux-mêmes au sein des communautés LGBTQIA2S et comme bispirituel.le.s et/ou indigiqueer. À travers le thème du "désir, de l'euphorie, du désespoir et de la dysphorie", l'objectif de cette exposition est de remettre en question le rôle de la présence coloniale et les normes sociétales souvent contraignantes qui en découlent en matière d'identité.
Être bispirituel.le.s, c'est transcender les structures coloniales qui ont entouré de force l'identité et le genre.
Cette exposition ouvre un espace aux voix rarement entendues.
La résidence de commissaire et l'exposition, une collaboration daphne x articule, sont soutenues par le Conseil des arts de Montréal, Indigenous Arts Residency.
Eh káti’naióhton ne onkwa’nikòn:ra /
Mì àjaye ki midonenindjiganan pejigwan /
Et maintenant nos esprits ne font qu’un /
And Now Our Minds are One And Now Our Minds are One
daphne Cofondateurs, Hannah Claus, Skawennati, Caroline Monnet, Nadia Myre: Exposition inauguralesous la direction de Michelle McGeough
21 juin - 19 août

And Now Our Minds Are One rassemble pour la première fois les visions artistiques des quatre fondatrices de daphne : Hannah Claus, Caroline Monnet, Nadia Myre et Skawennati. La palette de matériaux, de médiums et de visions artistiques exprimée dans ces œuvres traite du lieu, de nos rapports et de nos responsabilités en tant qu’artistes Autochtones à l’égard du monde naturel et les uns envers les autres. Les travaux présentés célèbrent ces liens tout en pleurant la perte de certains d’entre eux. Ils témoignent d’une histoire commune et d’expériences vécues dans le cadre du colonialisme de peuplement, mais il ne s’agit pas pour autant d’une histoire de victimisation. Ces œuvres attestent que les femmes Autochtones sont au cœur de nos communautés encore aujourd’hui et bien au-delà.
Le protocole Ohén:ton Karihwatéhkwen (Les Mots avant toute chose) rappelle les rapports que les êtres humains sont censés entretenir avec l’ensemble de la Création et la responsabilité qui est la nôtre de les honorer dans le respect et l’humilité.[1] Pour les Onkwehón:we, cette connexion s’est formée lorsque la Femme du Ciel est tombée des cieux et a donné naissance à cette terre que nous connaissons sous le nom d’Île de la Tortue. La création de notre monde a été accomplie grâce à la coopération et à l’aide de toute la Création. Réciter le Ohén:ton Karihwatéhkwen, c’est se rappeler nos obligations à l’égard de tous les êtres vivants et reconnaître que notre survie dépend de ces liens. Les mots « ... et maintenant nos esprits ne font qu’un », prononcés après chaque formule de salutation et de reconnaissance du protocole, sont une marque de respect envers notre appartenance à ce système, et nous rappellent que toutes nos actions doivent en témoigner.
La reformulation futuriste du Ohén:ton Karihwatéhkwen de Skawennati est interprétée par l'avatar de l'artiste xox, en kanien'kéha, ainsi que dans les deux langues de la colonisation : l’anglais et le français. Dans le cyberespace, de nouveaux mondes sont envisageables : Skawennati assoit dans son œuvre la préséance de la langue kanien'kéha, laissant les autres langues tomber dans le silence à la fin de l’allocution. Son utilisation d’un avatar féminin, xox, rappelle au spectateur le rôle central des femmes dans les sociétés autochtones précédant la colonisation et souligne la continuité de la présence et du pouvoir des femmes dans de nouveaux mondes.
Reconnaître que nous sommes à l’aube d’un nouveau monde est le sujet d’Echo of a Near Future. Le tableau photographique monumental de Caroline Monnet brosse un portrait intergénérationnel captivant de femmes Autochtones. Chaque femme de cette composition dégage une présence qui défie le regard voyeuriste. Les habits de cérémonie qu’elles portent sont fabriqués à partir de matériaux de construction, évoquant un concept narratif qui exprime à la fois le foyer et sa fabrication. La photographie évoque non seulement l’avenir, mais aussi une manifestation du présent et du passé, car les motifs complexes découpés au laser de ces vêtements futuristes rappellent les techniques de broderie perlée transmises aux générations actuelles par les matriarches Anishinaabeg de la famille de Monnet.
Grâce à nos matriarches, nous traçons les lignes continues qui relient une génération à l’autre. Ces liens intergénérationnels sont renforcés et solidifiés par le partage d’histoires et de souvenirs communs. La sculpture de Nadia Myre intitulée Rita établit un lien entre deux femmes Autochtones : sa grand-mère, Rita, et la défunte artiste algonquine Rita Letendre. Myre précise qu’il ne s’agit pas d’un hommage à ces deux femmes, mais d’une consécration de l’influence qu’elles ont exercée sur sa vie et sa pratique artistique. Ritafait partie d’une série d’œuvres en cours que Myre qualifie de peinture expérimentale avec de l’argile. Comme l’explique l’artiste, ces abstractions d’argile s’inspirent de photographies de levers et de couchers de soleil prises par Myre; elles sont comme des récipients et, à ce titre, sont capables de contenir des souvenirs et des désirs.
L’installation de Hannah Claus, teyoweratà:se (vents tourbillonnants), évoque la beauté et la puissance de la nature. Claus y capture l’énergie et la tension créée par la convergence de forces opposées. Elle concrétise l’invisible d’une manière particulièrement tangible et puissante, capturant la tension créée par l’anticipation de l’instant. Le résultat est d’une beauté terrifiante. Même si nous n’en comprenons pas les principes scientifiques, nous connaissons instinctivement les conséquences de ce phénomène météorologique. teyoweratà:se est l’une des nombreuses manifestations de l’air que nous respirons; lorsque nous entrons dans ce monde, notre premier acte est de respirer cette force vitale, de même que notre dernier acte lorsque nous passons dans l’autre monde.
Le Ohén:ton Karihwatéhkwen nous rappelle nos responsabilités et notre place au sein de la Création. Le colonialisme de peuplement a tenté de rompre ces liens, qu’il s’agisse de notre rapport au monde naturel ou de nos liens interpersonnels. Aussi ténues soient-elles, nous savons que notre survie en tant que peuple dépend de ces connexions.
[1] Words that come before all else: Environmental philosophies of the Haudenosaunee. Île Cornwall, Ont.: Native North American Travelling College, 2000. p.8.
Shii'itsüh | Pleurs dans le cœur | Crying in the Heart
Theresa Vander Meer-Chassé
13 mai - 30 juin

Teresa Vander Meer-Chassé est une fière Niisüü, membre de la Première nation de White River, originaire de Beaver Creek, du Yukon et de l'Alaska. Elle réside actuellement dans les territoires de Songhees, Esquimalt et W̱SÁNEĆ à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle est une artiste visuelle Upper Tanana, Frisonne et Française, commissaire émergente, et candidate à la maîtrise en arts plastiques à l'Université Concordia. Sa pratique des arts visuels est investie dans le réveil de matériaux endormis et la réanimation d'objets trouvés qui sont enracinés dans des compréhensions de l'identité.
Pour faire face au deuil et à la perte, j'ai créé un abri littéral et métaphorique qui a été récupéré, reconstruit et revitalisé. Après avoir vécu un profond conflit interne à la suite de la perte d'un autre membre de ma famille pour cause de toxicomanie, je vous invite à entrer dans Nee' Shah | Our House pour constater l'importance de l'éveil des matériaux endormis comme méthode de gestion de la perte. En transformant des matériaux naturels avec ma famille, j'essaie de vous faire prendre conscience des cycles universels de la perte, du chagrin et du deuil.
En guise de correctifs, je traduis des textes que j'ai envoyés à des membres de ma famille que j'ai perdus ou qui souffrent actuellement de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives. Je ne souffre pas personnellement de troubles liés à l'utilisation de substances ; je ne suis qu'un témoin et un être cher pour de nombreuses personnes qui souffrent ou ont souffert de troubles liés à l'utilisation de substances. Les symboles, les couleurs et les motifs qui représentent mes familles et mes communautés Upper Tanana, Frisian et French sont présents dans toute la tente et servent de protection, d'ancrage et de connexion. Les matériaux naturels ont été collectés et traités en collaboration avec la famille et sont devenus un rituel quotidien dans ma croissance personnelle et ma guérison.
AVERTISSEMENT SUR LE CONTENU : Cette exposition aborde les thèmes de la perte, du deuil et de la toxicomanie. Hǫǫsǫǫ dìik'analta' de' (prends soin de toi).
Nee’ Shah /Notre maison 2023
Taathǜh (tente en toile) - J'ai recyclé et récupéré une tente murale en toile usagée de ma communauté de Tthèe Tsa' Niik (Beaver Creek, Yukon). Il y a plusieurs tentes murales à Tthèe Tsa' Niik et dans les environs, mais beaucoup d'entre elles sont neuves et utilisées activement. La rumeur veut que la tente murale que ma grand-mère Nelnah Bessie John avait à son camp de pêche soit encore là. Avec la permission de la famille et de la Première nation de White River, j'ai prévu de visiter le camp de pêche avec mon père Wilfred Chassé. Avant de partir, nous avons parlé à mon oncle Ricky Johns qui nous a dit qu'ils avaient déjà jeté la tente de grand-mère Bessie un été ou deux auparavant, mais qu'il y avait peut-être encore quelque chose que je pourrais utiliser.
Le Fish Camp de Grandma Bessie est situé juste en face de la frontière internationale, le long de la route de l'Alaska, qui sépare le Yukon de l'Alaska. Lorsque j'étais jeune, le Fish Camp était accessible à pied, mais depuis quelques années, avec le développement de la route et les effets du changement climatique, il faut un canoë pour accéder au site. Mon père et moi avons chargé un canoë pour deux personnes dans son camion et il m'y a conduit tôt le matin. Il s'agissait d'une belle journée ensoleillée. Nous avons déchargé le canoë et nous avons lutté dans la boue pour le mettre à l'eau. C'était la première fois que je faisais du canoë sur ce lac, qui était magnifique mais peu profond par endroits. Après nous être extirpés des mauvaises herbes, nous avons atteint les rives de Fish Camp.
Nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. J'étais un peu inquiet que nous ne trouvions rien à utiliser, mais dès que j'ai passé une structure tombée, j'ai trouvé une vieille toile pourrie sur le sol. Nous avons fini par mettre la toile de tente dans le canoë et nous avons pagayé jusqu'à l'autoroute. Pendant que nous pagayions, deux cygnes se sont envolés à côté de nous, ce qui a marqué un merveilleux moment de récupération, de famille et de redécouverte. J'ai transporté la tente murale jusqu'à Victoria, en Colombie-Britannique, où ma mère Janet Vander Meer et moi avons passé une semaine à la nettoyer pour la débarrasser de toutes les moisissures et autres toxines. J'ai terminé la reconstruction de la tente murale au Ministry of Casual Living dans le centre-ville de Victoria.
Ch'ithüh (peau tannée à la maison) - Tout au long de ma maîtrise en beaux-arts, j'ai passé la majorité de mes étés à Tthèe Tsa' Niik à travailler sur un dinǐik thüh (peau d'orignal) avec ma mère Janet Vander Meer et ma grand-mère Marilyn John. Le partenaire de ma mère, Dwayne Broeren, a abattu un dinǐik choh (grand orignal mâle) à l'automne 2020. Ils ont dépecé le dinǐik et laissé la chair dehors pour qu'elle gèle pendant l'hiver. Pendant les mois froids, un loup affamé est entré dans la communauté à la recherche de quelque chose à manger. Le loup a fini par détruire la peau et a laissé un petit morceau de la croupe sur le poteau d'éviscération. Je n'étais pas assez confiant pour travailler sur un dinǐik thüh choh pour commencer, donc le petit morceau de croupe était le plus logique. Cependant, j'ai vite appris que de nombreux tanneurs de peaux enlevaient la croupe parce que la peau est assez épaisse et que sa forme la rend difficile à gratter.
Le premier été, j'ai vécu avec ma grand-mère et nous sommes allées aussi loin que possible dans le dinǐik thüh grâce à ses souvenirs. Je lui posais des questions sur son enfance, avant qu'elle ne soit forcée d'aller au pensionnat de Lower Post. Je lui demandais ce qu'elle se rappelait de sa mère et de sa grand-mère en train de tanner des peaux, ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait et ce qu'elle entendait. Nous sommes allées assez loin dans le processus, jusqu'à ce que nos souvenirs ne suffisent plus et que nous ayons besoin d'aide. Une communauté de jeunes tanneurs de peaux est venue à notre secours et nous a offert ses connaissances et ses compétences, ce qui nous a beaucoup aidés. Malheureusement, lors de mon dernier voyage pour achever la peau, nous avons été confrontés à divers facteurs qui m'ont empêché de fumer la peau correctement.
Ayant l'impression d'avoir échoué et de perdre le dinǐik thüh sur lequel nous avions travaillé pendant deux ans, ma grand-mère Marilyn avait une solution. Elle avait conservé deux ch'ithüh que sa sœur Nelnah Bessie John avait terminés avant son décès en 2000. Grand-mère Bessie était la dernière personne à avoir réussi un ch'ithüh dans la communauté. J'ai décidé d'utiliser la peau que Grand-mère Bessie avait déjà commencé à découper avant son décès. Je suis honorée et très reconnaissante à ma grand-mère Marilyn de m'avoir permis d'exposer cette pièce. Ce n'est certainement pas la fin de notre voyage de tannage, juste le début.
Mēet Thüh (peau de truite de lac) - Shnąą Thielgay eh naach'akch'įǫ. Ma mère Janet Vander Meer, son partenaire Dwayne Broeren et le frère de ce dernier, Doug Broeren, m'ont emmené pour mon premier voyage de pêche officiel au lac Kluane au cours de l'été 2021. C'était censé être le concours de pêche annuel, mais en raison de la pandémie de COVID-19, il a été annulé cette année-là. Malgré l'annulation de l'événement organisé, de nombreux bateaux ont tout de même décidé de sortir sur le lac ce jour-là. Le touladi, le poisson blanc et l'ombre sont les poissons les plus courants sur le territoire de la Première nation de White River. Ma mère et moi avons attrapé un gros touladi de 20 livres lors de cette navigation, mais nous l'avons mangé et n'avons pas gardé la peau.
J'ai appris à tanner le ∤uuk thüh (peau de poisson) avec Janey Chang, artiste et tanneuse basée à Vancouver. J'ai suivi un atelier en ligne avec Janey et j'ai tanné plus de 40 peaux pendant que j'étais à Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal pour mon dernier semestre de cours. À mon retour à Tthèe Tsa' Niik, Dwayne m'avait gardé un ∤uuk thüh à tanner qui provenait de notre territoire traditionnel. J'ai décidé de tanner le mēet en utilisant la méthode à l'huile. J'ai reçu une recette de l'artiste Beaver Cree Cheryl McLean et elle a fonctionné à merveille. Avec ma grand-mère Marilyn John, ma mère, ma tante Rosemarie Vandermeer et ma nièce et filleule Sophia Vandermeer, nous avons travaillé à la transformation du mēet thüh. Quatre générations de mains ont touché ce ∤uuk.
Dinǐik Tth'èe (babiche d'orignal) - Ma mère Janet Vander Meer et son partenaire Dwayne Broeren ont chassé un dinǐik et l'ont dépecé sur place. Mon oncle David Johnny était venu les aider à découper le dinǐik. Il leur a raconté des histoires et a identifié le dinǐik tth'èe qu'ils ont découpé et conservé pour moi. Bien avant de m'intéresser au tannage d'une peau, j'étais plus désireuse d'apprendre à filer la babiche. Je me souviens d'avoir vu ma grand-mère Marilyn John le faire quand j'étais jeune, mais je voulais l'essayer moi-même. Mon grand-père Sid van der Meer m'a envoyé le dinǐik tth'èe par la poste et ma mère et moi avons appris à filer avec ma grand-mère par le biais d'un haut-parleur. Nous l'avons écoutée et lui avons dit à quoi cela ressemblait. J'ai emporté le tendon lors d'un autre voyage à la maison et ma grand-mère m'a félicité pour avoir filé le tendon correctement.
Donjek (perles de rocaille argentée) - Ma mère Janet Vander Meer, mon grand-père Sid van der Meer et moi-même avons décidé de faire une excursion à la rivière White. Je voulais collecter des sédiments de cendres sur les rives de la rivière pour un projet. Mon grand-père aime jouer les guides touristiques et c'est une région qu'il n'avait pas explorée depuis longtemps. Il possédait une cabane et un commerce le long de l'autoroute, près de la rivière White. Ce fut la première maison de ma mère. La structure est maintenant récupérée par le nän' (la terre). Nous avons passé toute la matinée à ramasser des cendres, des pierres et du bois flotté le long de la rivière. Alors que nous nous asseyions pour reprendre notre souffle, j'ai remarqué un buisson rempli de baies d'argent. J'étais stupéfaite, car je ne savais pas où poussaient les jik (baies). Je savais qu'elles contenaient une graine qui était et est encore utilisée aujourd'hui pour fabriquer des perles. Nous en avons ramassé autant que nos poches pouvaient en contenir et nous les avons ramenées à Tthèe Tsa' Niik pour qu'elles soient nettoyées et séchées. Ma grand-mère Marilyn John nous a dit qu'on pouvait manger ces baies et que les graines étaient utilisées pour fabriquer des perles, mais que cette pratique n'était plus aussi courante aujourd'hui.
Nuun Ch'oh (piquants de porc-épic) - J'ai ramassé ces nuun ch'oh avec ma mère Janet Vander Meer sur un nuun que Dwayne Broeren avait tué pour mon oncle Patrick Johnny. Ma mère et moi étions assis à l'arrière de sa Ford F150 pour arracher et frapper le nuun avec une serviette afin de recueillir autant de piquants et de poils que possible. Nous devions faire vite, car mon oncle Pat était impatient de manger ! Après avoir ramassé autant de nuun ch'oh que possible, nous avons regardé mon oncle Pat utiliser un chalumeau pour arracher le reste des piquants et de la fourrure avant de le dépecer et de l'éviscérer. Apparemment, les pieds sont très savoureux, mais je ne me suis pas laissé tenter.
Fil de mouton brun de Nouvelle-Zélande - J'ai reçu deux tapis de mouton brun de Nouvelle-Zélande de Shuudèh Wunąą (My Sweetheart's Mother) Rosyland Frazier. Au début, je n'étais pas sûre de ce que j'allais en faire, mais en un clin d'œil, j'ai décidé d'apprendre à filer. J'ai acheté quelques outils simples dans un magasin de fil local et j'ai regardé plus de tutoriels en ligne qu'il n'en faudrait. J'ai décidé d'utiliser le fil filé à la main dans un motif de point de couverture à certains endroits de la tente.
Melton/Stroud – Le melton est une étoffe de laine tissée qui remonte aux débuts de la traite des fourrures dans ce que l'on appelle aujourd'hui le nord du Canada. Jusqu'à récemment, le Canada avait sa propre entreprise de melton, mais elle a fermé et nous devons maintenant importer du melton (ou du stroud). Ma première robe de danse était en feutre rouge et j'ai récemment confectionné une tunique en stroud blanc et rouge pour ma grand-mère Marilyn John. Lors de la création de Nee' Shah | Our House, j'ai voulu utiliser les couleurs de notre famille - le rouge et le noir - avec du melton. J'ai découpé le melton en symboles représentatifs des communautés du Haut Tanana. J'ai eu la chance de voir certains de ces symboles sur des œuvres des aînés de nos aînés lors de ma visite au McCord-Stewart Museum et au Field Museum.
Autres matériaux : toile, tissu de coton, fil à broder, fil à crochet, fil de nylon, fil de coton, fil de polyester, perles de verre, perles de rocaille vintage, perles delica galvanisées, tuyaux et raccords en ABS, raccords en métal, notions, corde
Tsin'įį choh (grand merci) à tous ceux qui m'ont soutenue dans mon parcours d'apprentissage. De l'apprentissage pratique au partage de souvenirs, d'histoires et de langues, j'ai eu la chance d'avoir de nombreux enseignants au cours de ces dernières années, alors que je préparais mon master en beaux-arts. Ce voyage n'aurait pas été possible sans les contributeurs et soutiens suivants : Janet Vander Meer, Marilyn John, Wilfred Chassé, Dwayne Broeren, Sid van der Meer, Christopher Walton, Lisa Jarvis, Rosemarie Vandermeer, Tuffy Vander Meer, John Vandermeer, Jordan Vandermeer, Deuce Vandermeer, Quanah VanderMeer, Sophia Vandermeer, Patrick Johnny, David Johnny, Ricky Johns, Jolenda Benjamin, Bessie Chassé, Courtney Wheelton, Montana Prysnuk, Angela Code, Janey Chang, Cheryl McLean, Jesse Lemley, Rosyland Frazier, White River First Nation, Ministry of Casual Living, Field Museum, McCord-Stewart Museum, YVR Art Foundation, Université Concordia Studio Arts Staff, Faculty, Studio Arts Staff, et à ses collègues, à Surabhi Ghosh, superviseur du MFA, au conseil d'administration et au personnel du Centre d'art daphne, à Lori Beavis, à John Player, et à tous ceux qui ont offert un mot d'encouragement ou une main secourable - merci.
Bebakaan
Carrie Allison, Christian Chapman, Matthew Vukson
Sous la direction de Lori Beavis
19 novembre 2022 – 28 janvier 2023

Avec nos remerciements à Alan Corbiere pour la traduction en Anishinaabemowin.
Bebakaan signifie "chacun est différent" en nishnaabemwin. Ce mot est apparu, avec l'aide précieuse d'Alan Corbiere, lors du traitement du ou des éléments des œuvres de cette exposition. Je pensais à des mots expressifs comme " alternativement " ou " échangeable " parce que, bien que les œuvres d'art soient liées les unes aux autres par la préoccupation du travail des perles, elles sont toutes d'une certaine manière différentes les unes des autres et différentes ou en dehors de nos attentes du travail des perles.
L'exposition de trois personnes, Bebakaan, à laquelle participent Carrie Allison (d'origine nêhiýaw/Cree, métisse et européenne), Christian Chapman (Anishinaabe) de la Première nation de Fort William, dans le nord de l'Ontario, et Matthew Vuckson (Tlicho Dene des T.N.-O.), qui vit et travaille à Lac Brochet, au Manitoba, fait passer le perlage du domaine de l'intime et du fixe à celui de la démesure, de l'animation et de l'immersion. Les œuvres présentées sont une méthode permettant à chaque artiste de discuter à sa façon du lieu, de la position, de l'histoire et de l'identité.
Le perlage est l'élément déclencheur des œuvres de Bebakaan. À travers l'histoire, la pratique du perlage a été largement reconnue par les peuples comme un moyen d'enregistrer et de traduire les connaissances culturelles. Christi Belcourt a écrit : "Le perlage est profondément enraciné dans les histoires et les relations terrestres liées aux histoires et aux récits... [en tant que tel] le perlage est porteur des histoires de l'adaptation des cultures au fil du temps".
La croyance culturelle selon laquelle le perlage - quelle que soit sa forme - permet aux gens d'entrer en relation les uns avec les autres et avec leurs propres terres, histoires, identités et visions du monde spécifiques à leur nation est démontrée dans cette exposition.
Les perles animées de Carrie Alisson font référence à ses ancêtres maternels et lui permettent de réfléchir à la perte culturelle intergénérationnelle et aux actes de récupération. Son travail combine des technologies anciennes et nouvelles pour raconter des histoires de terre, de continuité, de croissance et de guérison. TO HONOUR (2019) est une animation perlée expérimentale qui explore le concept du retour du perlage dans le paysage. Miyoskamiki (2020) est une animation perlée qui décrit la croissance d'un crocus des prairies, l'une des premières plantes à émerger lorsque l'hiver se transforme en printemps. Traditionnellement, les chasseurs et les fermiers guettaient ces plantes pour marquer le tournant des saisons. Nishotamowin (2020) est un mot nêhiyawin/cree qui signifie compréhension ou relation avec soi-même. Il s'agit d'une pièce audio qui réfléchit à la manière de " faire connaissance " ou de comprendre en écoutant les actions que nous réalisons. Le spectateur se connecte à l'audio par le biais d'un code QR pour écouter les sons qui filtrent à travers la fenêtre du studio d'Allison, ainsi que ses gestes de perlage amplifiés et ses pensées parlées.
Les œuvres d'Allison sont des gestes de recherche de compréhension et de connexion à la famille, à la langue et à la terre.
Christian Chapman crée ses peintures et ses sérigraphies pour raconter des histoires en utilisant souvent le style Woodlands. Il s'agit d'un style artistique distinct qui mêle histoires traditionnelles et supports contemporains avec des couleurs vives et des lignes audacieuses. Chapman est bien connu pour l'insertion de figures facilement reconnaissables - la princesse Diana, la reine Elizabeth II ou Elvis sur un champ plat où la figure est entourée de fleurs et de coquilles ou de peaux d'animaux. Cependant depuis 2017, il a été inspiré par la communauté créative des femmes qui fabriquent et perlent leurs regalia. Il s'est tourné vers les détails perlés plus complexes des regalia, dit-il, parce que sa partenaire et sa mère, ainsi que d'autres femmes de sa famille proche et élargie sont des travailleuses du perlage. Il a pris la décision de peindre les motifs perlés à une échelle très supérieure, afin de mieux comprendre les délicates perles de verre et les motifs floraux. En même temps, Chapman continue à travailler dans le cadre du patrimoine visuel des motifs de perlage Anishinaabeg comme méthode pour établir des liens avec les histoires et les récits familiaux, ainsi qu'avec la terre sur laquelle ces relations se sont formées.
L'artiste Tlicho Dene Matthew Vukson est un pédagogue. Enseigner aux autres fait partie d'un continuum qu'il a expérimenté - c'est sa mère qui lui a appris à perler et maintenant il enseigne cette compétence aux autres. Vukson aime partager les histoires qui lui ont été transmises par sa famille et il aime parler de son parcours de perles. Il utilise l'art comme une forme de réclamation et de réconciliation.
Dans l'œuvre immersive de cette exposition, il s'écarte du travail de perlage floral qu'on lui a enseigné pour s'intéresser à l'expérience de la violence et de la brutalité policière. Dans son travail, nous trouvons des badges de police, Police Badge 1, 2 (2019, 2020), des menottes Cuff'em (2022) et un nœud coulant de pendu, Calculating Weight (2022). Ces œuvres, qui évoquent des réactions brutales à l'égard du corps autochtone, sont contrebalancées par des images perlées qui présentent les cosmologies autochtones comme une source de guérison et de réconfort. Dans des œuvres telles que Place Before Time (2019) et Orbital Station NO 2(2021). Tandis que d'autres œuvres comme Red Walker (2018) et Octavial (2019) nous rappellent la force dans laquelle nous pouvons puiser lorsque nous retournons à la terre pour marcher dans la forêt, les masses de fleurs sauvages, ou pour nous asseoir et regarder les aurores boréales dans Place Before Time (2019).
Bien que dans cette exposition, le travail de Vukson se situe plus profondément dans le domaine du perlage habituel, son sujet va au-delà de nos attentes en matière de perlage. Allison et Chapman modifient également la notion de perlage en tant que jeu avec le mouvement et l'échelle. Pourtant, ces trois artistes mettent en évidence, à leur manière, la continuité de la tradition du perlage ancrée dans l'art indigène, avec une différence.
Versification/ Teskontewennatié:rens
January Rogerscommissaire Ryan Rice
10 septembre 2022 - 29 october 2022
Versification en 10 questions
Ryan Rice : Compte tenu des règles et des structures occidentales qui régissent l’écriture de la prose et que vous contestez manifestement dans votre travail, pouvez-vous décrire ou définir comment le titre de l’exposition Versification représente l’ensemble des œuvres présentées ? Peut-on le concevoir ou le lire comme une (ré)action décolonisatrice ?
January Rogers : Excellente question! J’ai bien aimé le titre Versification et je l’ai choisi parce qu’il fait si bien référence à la promotion et à l’utilisation des vers activés dans la poésie qui circule sous diverses formes au sein de l’exposition. J’utilise le langage comme une invitation, à travers les mots et les images par lesquels ou à travers lesquels le spectateur est invité à découvrir un sens évolutif et une interprétation personnelle dans chacune des pièces. À un moment précis de ma vie, j’ai consciemment choisi de me tourner vers la poésie ou, plutôt, j’ai permis à la poésie de me montrer la voie à suivre pour m’exprimer. J’ai ainsi abandonné ma pratique des arts visuels pour consacrer mon attention et mes efforts à l’écriture. Toutefois, ma pratique initiale est revenue après un temps sous forme de création audiovisuelle. Il s’agit d’un processus de création très concret au sein duquel je marie la poésie à la vidéo et la prestation. Ainsi, peut-être que la combinaison de ces formes d’art, comme le fait de se débarrasser des paramètres oppressifs de la « littérature traditionnelle », pourrait être considérée comme une réaction décolonisatrice, mais, en toute honnêteté, si ma pratique génère une réaction décolonisatrice, il s’agit d’un phénomène qui découle de moi, mettant mes créations au service de mes passions.
RR : Votre pratique artistique principale en tant que poète est amplifiée par votre expérimentation et votre maîtrise des médias (son, performance, vidéo) et est étoffée par des références à la justice sociale et une critique mordante des systèmes coloniaux qui nous oppriment. À quel moment, en tant que poète, avez-vous incorporé et intégré ces outils (médias) dans votre travail ? Comment ont-ils amplifié votre voix ?
JR : Eh bien, je ne suis pas certaine que l’intention était d’amplifier ma voix, mais la pratique elle-même a amplifié ma joie. Grâce à mon travail et à mon expérience à la radio, j’ai acquis quelques compétences en matière de réalisation sonore et j’ai pris ce petit bagage de connaissances pour le mettre à profit. J’ai eu beaucoup de plaisir à expérimenter avec le son et je me suis rendu compte que le son est une expression tellement ancienne; qu’il est possible de produire une narration uniquement avec le son. Une fois de plus, mes pratiques se sont chevauchées : écriture, son, radio, spectacle, musique, voix, etc.
Eh oui, je commente mon travail. Je suis obligée de le faire. Cela fait partie de ma responsabilité en tant que femme et artiste Haudenosaunee. Je dois poser ces jalons dans le temps, même si je dois puiser dans mes droits culturels ancestraux pour les mettre en lumière aujourd’hui. Ces pièces représenteront une interprétation contemporaine de nos enseignements et des événements historiques. Je dois me représenter en tant qu’artiste et je deviens un peu plus audacieuse dans mes pratiques en y intégrant mon histoire personnelle.
RR : J’admire ta polyvalence et la férocité de ton esprit créatif, ainsi que son absence de retenue. Qu’est-ce qui te motive ? Qu’est-ce qui t’inspire ?
JR : Eh bien, c’est le mot exact! C’est « l’esprit créatif », cet esprit m’habite depuis l’enfance. Et même si je n’ai pas choisi d’« étudier » l’art ni eu le privilège de connaître ceux qui m’ont précédé et d’apprendre à utiliser un langage artistique approprié dans le cadre d’une formation classique, j’ai fini par acquérir ces connaissances en effectuant des résidences et en travaillant aux côtés d’autres personnes dans le cadre de collaborations, ainsi que par mes propres recherches et mes propres pratiques. Je n’ai donc pas eu à désapprendre quoi que ce soit pour trouver ma voix en tant qu’artiste. Elle s’est développée en ajoutant, et non en enlevant quoi que ce soit. Je n’ai jamais eu à utiliser ce langage « classique » d’artiste pour faire croire que je pouvais générer un intérêt de la part du public relativement à mes œuvres parce que je ne le possède pas. J’ai de la poésie. J’ai des instincts. J’ai cet esprit qui guide mon travail. Je suis inspirée par l’honnêteté des expériences vécues et je suis motivée par un réel sens de la responsabilité dans l’utilisation des dons et des possibilités que j’ai été si chanceuse de recevoir dans ma vie.
RR : Ressentez-vous un sentiment d’urgence à « produire » (à savoir, faire de l’art) ? Si oui, cette urgence est-elle le moteur de votre travail ?
JR : Non.
RR : En tant qu’artiste à plein temps (au sens large), où trouvez-vous l’énergie pour gérer et mener de front non seulement l’environnement littéraire, mais aussi de multiples projets qui s’étendent à la culture visuelle et aux médias.
JR : Par moments, la gestion de ces projets devient un merveilleux casse-tête, une danse complexe. Mais, là encore, c’est quelque chose que je fais depuis l’enfance. Je me souviens qu’en cinquième année, j’écrivais des pièces de théâtre et je demandais à tous mes amis de les jouer. Il s’agissait de pièces très féministes, qui mettaient le personnage féminin en évidence, en tant que protagoniste de l’histoire. J’ai été élevée par une mère féministe dans les années 70 et 80, à une époque où le mot « féministe » était lié aux mots « libération des femmes ». Autres temps, autres contextes. Mais en tant que jeune écrivaine, j’ai également été soutenue par ces communautés. J’ai toujours été une personne autonome et je crois que je suis faite pour gérer ma carrière tout en étant la créatrice que j’ai besoin d’être. Je sais que ce n’est pas le cas pour tous les artistes et, depuis mon retour à Six Nations, j’ai mis mes compétences en gestion au service de certains musiciens et événements locaux. C’est un travail qui me nourrit vraiment. Il n’est donc pas du tout surprenant que je me sente tout à fait à l’aise dans le rôle de « productrice » pour mes propres projets et en collaboration avec d’autres.
RR : Dans votre démarche de prestation, votre présence est audacieuse, sans artifice et retient l’attention. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de constater que vos actions sont réfléchies et bien pesées. Comment créez-vous cette dynamique ? Êtes-vous consciente du public et de ses réactions ? Est-ce important pour vous ?
JR : Le public ne joue aucun rôle dans le développement de mon travail de prestation. Ce qui est important, c’est que je reste dans l’instant, que j’évoque l’« esprit » de l’œuvre en moi, que je le ressente en moi pendant la représentation, car cet « esprit » se manifestera pendant la représentation. C’est tellement puissant. Il y a tellement de choses qui peuvent être transmises par l’art-performance et la découverte du langage qui vient de mon corps, de mon mouvement et de la combinaison d’actions et d’interactions avec les objets me passionne pleinement. La mesure du succès d’une représentation, pour moi, c’est le silence piquant d’un public profondément captivé parce que je suis tellement engagée dans mon propre espace, mes pensées et ma méditation en temps réel. Je crois que nous pouvons définir les éléments connus de l’art-performance. Nous pouvons les nommer et les enseigner. Mais je pense que ce que j’aime tant dans les arts de la scène est identique à ce que j’aime dans le « spoken word », à savoir que nous le définissons en le faisant et que lorsque nous continuons à le faire (authentiquement), nous en élargissons la définition. Ces pratiques, comme la culture elle-même, sont vivantes et en pleine croissance. Elles doivent évoluer et défier à la fois le spectateur et, surtout, l’artiste.
RR : Quelle a été votre expérience dans la production des poèmes visuels de l’exposition traitant des conséquences des pensionnats et du Mush Hole en particulier ? Quel rapport entretenez‑vous avec cette histoire?
JR : Tout d’abord, les images sont tirées du projet de performance documenté que mon frère et collaborateur Jackson 2bears et moi avons réalisé au Mush Hole, alias Mohawk Institute, alias le Pensionnat de Six Nations, en 2016. Jackson a une histoire plus directe et connue avec le Mush Hole à travers l’histoire de son grand-père paternel. Mon histoire familiale avec cet endroit est moins connue, mais je sais que mes grands-parents paternels ont été actifs au sein des églises anglicanes de Six Nations, ce qui les a bien sûr éloignés des traditions et des pratiques culturelles Haudenosaunee. Il y a donc eu un bouleversement évident depuis leur génération, si ce n’est plus longtemps avant. Les poèmes qui accompagnent ces images sont (plutôt) récents. Ils ont été écrits lors d’un voyage à Venise, en Italie, en avril 2022, un voyage très difficile pour moi à bien des égards. Ce voyage a été très éprouvant pour moi à bien des égards. Il m’a toutefois offert l’occasion de mener une grande réflexion sur moi-même et de rédiger plusieurs poèmes. J’ai inclus certains d’entre eux dans les images du Mush Hole. C’est ici que je raconte mon histoire. La honte de grandir en étant visiblement autochtone, la perte de ma sœur — la seule autre personne au monde qui partageait mon histoire, les effets négatifs indéniables que les pensionnats ont sur ma réalité aujourd’hui. J’ai survécu. Je m’épanouis. Je célèbre cette année 31 ans de sobriété. Le fait de retourner dans cet institut avec des images de ma famille a été très transformateur. Grâce à ce projet de performance, j’ai pu changer ma relation avec cet endroit en étant consciente de ma présence et de la présence des esprits de ceux qui y sont passés. Leur énergie est palpable. Je peux les sentir écouter lorsque je leur parle.
RR : Étant membre de la communauté de Six Nations, quelle est votre relation avec Pauline Johnson ? Faites-vous des rapprochements avec votre propre parcours d’écrivaine et d’interprète Haudenosaunee ?
JR : Réponse courte : oui. La réponse longue est que je crois qu’elle s’est épanouie en tant qu’auteure et interprète par besoin de s’exprimer, par amour du théâtre, par désir de rester libre et par désir naturel d’être sa propre personne. Je fonctionne de la même manière en tant qu’artiste et en tant que femme Haudenosaunee. Le fait de ne pas avoir d’enfants peut parfois vous faire passer pour une anomalie au sein de la communauté autochtone. Pauline n’a pas eu d’enfants (bien qu’il y ait des rumeurs...). Et je ne vois pas cela comme un sacrifice pour ma carrière. Je tiens beaucoup à ma liberté et je ne vois pas grand-chose d’autre que ce monde puisse m’offrir qui soit plus attrayant que cela. Ce que je partage avec Pauline en tant qu’interprète, c’est la manière dont nous avons appris à faire cette chose qu’on appelle la poésie de performance. À part les artistes de théâtre que Pauline Johnson admirait, il n’y avait personne qui faisait ce qu’elle faisait à son époque. Et il en a été de même pour moi. Lorsque j’ai décidé de faire évoluer mon travail vers une pratique de la poésie de performance, tout a été développé par moi-même et, heureusement, la plupart des projets ont fonctionné. Nous partageons donc une nature innovante, un programme pro-femmes et pro-autochtones à partir duquel notre poésie trouve son inspiration et, bien sûr, l’amour et le besoin de voyager pour faire avancer nos carrières.
RR : Le rôle de l’« orateur » est fondamental dans la culture Haudenosaunee. Avez-vous l’impression de faire progresser cette tradition avec votre propre pratique ? Dans quelle mesure est-il important de raconter et d’être entendu ? Dans quelle mesure est-il important d’écouter ?
JR : Encore une excellente question, Ryan. Tu as été témoin de la performance que j’ai organisée avec des radios et, si tu te souviens bien, dans mon discours après la performance, j’ai dit que je crois que nous sommes tous comme des radios. C’est-à-dire que nous avons la capacité de transmettre (envoyer des signaux) et de recevoir. Encore une fois, je fais référence à nos énergies. En tant que poète qui prend la parole plutôt que de lire ses mots, bien que je les lise aussi parfois, je crois que la façon dont nous (les auteurs autochtones) participons à la « littérature » n’est qu’un tremplin pour nous ramener à la pratique originale de l’art oratoire. Dans nos sociétés actuelles, de nombreux rôles font appel à l’art oratoire dans leurs activités, comme les avocats, les comédiens, les enseignants, les orateurs de la Maison longue, les politiciens, etc. L’acte de « parler » n’a donc jamais vraiment disparu. La raison pour laquelle j’ai commencé à faire du spoken word, c’était pour que mes mots puissent être entendus; pas moi, mais mes mots. Je voulais les honorer en leur donnant la meilleure chance possible d’être entendus. Au fil du temps, après que mes nerfs se soient calmés, parce qu’il y a une peur de perdre ses mots en plein discours, j’ai commencé à présenter avec un sens naturel de la présence et des gestes sur scène. J’ai commencé à m’amuser avec tout ça.
RR : Les objets tangibles que vous créez et les matériaux que vous incorporez et produisez pour vos performances, vos œuvres médiatiques comme les costumes, les accessoires, les poupées de maïs, les tremplins, les cigarettes roulées, etc., deviennent tous des représentations artistiques/créatives qui incarnent votre présence et qui demeurent actives comme traces de votre absence. Dans le cas de Versification, de votre performance et de votre collaboration avec Jackson 2Bears (artiste d’installation multimédia/performance Kanien'kehaka et théoricien culturel originaire de Six Nations), comment les vestiges exposés incarnent-ils l’essence de votre performance ?
JR : Je dirais qu’à travers la performance, nous ne créons pas seulement des expériences et des souvenirs, mais aussi des preuves de notre présence à travers les objets laissés derrière nous. Dans le cas de la performance Spirit Shadow, qui fait partie de l’exposition Versification, Jackson 2bears et moi-même laissons littéralement des silhouettes de nous-mêmes dans la galerie. Nous créons un espace négatif en forme de nous-mêmes, distingué par les médecines que nous utilisons dans une cérémonie de protection, croyant que les méthodes et les actions que nous évoquons pour nous protéger dans la performance, sont si évidentes, que même en notre absence, nous restons....protégés, en quelque sorte.
Nikotwaso
Catherine Boivin
commissaire Jessie Ray Short
9 juillet - 27 août, 2022

In the Round: Catherine Boivin, par Jessie Ray Short (rev. octobre, 2023)
Le travail de Catherine Boivin est centré sur des événements qui la touchent personnellement, en tant que femme et mère atikamekw vivant dans une communauté autochtone du Québec actuel. Lors de nos conversations vidéo, j’écoute attentivement Catherine me parler des concepts qui sous-tendent son œuvre, intitulée Nikotwaso. Lors de ces rencontres, la petite fille de Catherine joue en arrière-plan ou grimpe sur ses genoux. Nos discussions tournent autour de divers sujets, notamment les intérêts actuels pour le cinéma et la télévision, l’art vidéo, les connaissances culturelles de nos communautés autochtones respectives, l’importance des langues autochtones et de leur enseignement aux générations futures, ainsi que la violence sexiste dont sont victimes les femmes autochtones au Canada.
Catherine souligne qu’elle se sent aujourd’hui investie d’une grande responsabilité dans la résolution de ces problèmes, afin que sa langue et sa culture restent vivantes pour sa fille. De veiller à ce que sa fille vive pour sa culture et sa langue. Ces préoccupations continuent d’être exprimées par les peuples autochtones. On peut affirmer que dans ce pays, « un récit national [a été créé et] est fondé sur le génocide des autochtones... Pendant trop longtemps, on s’est intéressé aux cultures autochtones, mais pas aux Autochtones eux-mêmes ni à leur bien-être ».[1] Il n’y a pas de culture sans les personnes dont elle est issue. Pour une jeune femme comme Catherine Boivin, la question des femmes autochtones assassinées et disparues continue de la hanter, comme c’est le cas pour les populations autochtones à l’échelle nationale (y compris au Québec).[2]
Dans cette exposition, Catherine et les femmes qui participent à son projet courent en cercle sur les moniteurs, évoquant les nombreuses dimensions de leur identité. Elles courent en cercle pour rester actives, pour prendre soin d’elles-mêmes; elles courent en cercle pour refléter les cycles de la vie, y compris les changements de saison; elles courent en cercle pour symboliser les cycles de la violence qui les exposent, en tant que femmes autochtones, à un risque beaucoup plus élevé de subir des violences que les autres populations de femmes du pays.
Le travail de Catherine est toutefois nuancé; il touche aux récits de traumatismes autochtones tout en allant plus loin. En parlant avec Catherine de Nikotwaso, je suis frappée par les similitudes entre son travail et celui de Dana Claxton, tant sur le plan matériel que conceptuel. Lors d’une conférence d’artiste, Dana Claxton précisait que l’attention qu’elle porte à la mode et aux normes de beauté dans son travail sert à remettre en question l’« impérialisme esthétique » des normes eurocentriques, de son point de vue en tant que Hunkpapa Lakota, et à la « recherche de la beauté et de l’esthétique autochtone ».[3]
Le travail de Catherine, comme celui de Dana, ne supprime pas les vêtements comme tels, mais y intègre[4]plutôt des éléments culturels. L’intention est d’incorporer des éléments historiques observés sur les vêtements atikamekw portés par les ancêtres de Catherine, comme les jupes à ceinture et à carreaux, tout en ajoutant des éléments de conception inspirés de la vision éclectique de la chanteuse islandaise Bjork.[5]
Nikotwaso est une œuvre de cercles et de cycles. C’est une œuvre circulaire. Catherine conjugue le passé et le futur au présent, avec un regard sur ses grands-mères, sur sa fille et sur les générations futures, tout en faisant référence à divers éléments visuels, qu’ils proviennent de la culture pop, du cinéma et de la télévision, ou de l’esthétique culturelle atikamekw contemporaine et historique. Nikotwaso demande au public de mettre en suspens ses convictions, ou ce qu’il croit savoir des femmes autochtones, et d’entrer dans les possibilités concentriques créées par Catherine Boivin.
Pour aller plus loin :
Bowen, Deanna, et Maya Wilson-Sanchez. A Centenary of Influence. Canadian Art. (20 avril, 2020). Consulté le 25 mai 2020. https://canadianart.ca/features/a-centenary-of-influence-deanna-bowen/.
Ryerson Image Centre. Artist Talk with Dana Claxton. 1:00:55. youtube.com: Toronto Metropolitan University, 2021. Artist Talk. https://www.youtube.com/watch?v=zv6qeQTB4Yg.
La Commission a publié un rapport sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Québec, qui peut être consulté ici en anglais : https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Final_Report_Vol_2_Quebec_Report-1.pdf
Version française : https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf
[1] Wilson-Sanchez, Maya.
[2] Consultez les rapports de l’ENFFADA cités dans la bibliographie pour en apprendre davantage.
[3] Claxton, Dana.
[4] Claxton, Dana.
[5] Entretien privé avec Catherine Boivin le 6 mai 2022.
translations: Suzanne Morrissette
7 mai - 18 juin 2022
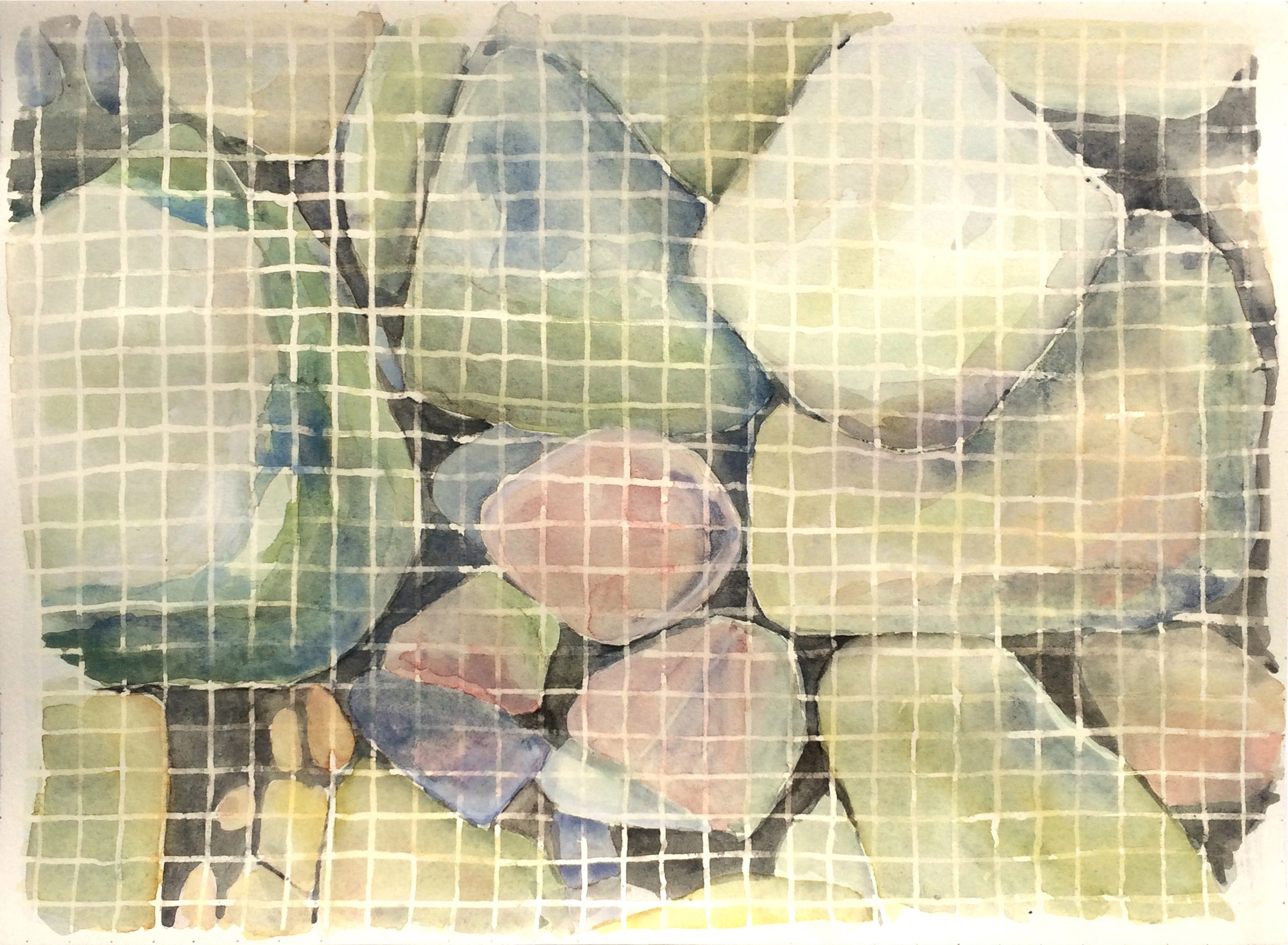
Texte de Jenny Western
En 2022, à la fin de l'hiver, Suzanne Morrissette et moi avons pris le temps de discuter et de nous retrouver. Depuis que je l'ai rencontrée, il y a plus de dix ans, j'ai toujours été fascinée par la façon dont Morrissette pense, communique et représente ses idées. translations couvre le travail artistique de Morrissette de 2013 à 2022 et retrace l'élaboration de sa pratique au cours de cette décennie. Tout au long de notre conversation, elle m'a fait part de ses réflexions sur son exposition, mettant en lumière un ensemble d'œuvres à la fois cohérentes et autonomes.
Les premières œuvres de l'exposition forment une série de quatre photographies sans titre. Morrissette y apparaît, semblant escalader de vastes montagnes, s'adosser à des falaises rocheuses et, de manière générale, s'intéresser aux paysages. Pourtant, quelque chose cloche. Son corps, en particulier, semble disproportionné. Des éléments clés manquent; sur une photo, des parties de sa jambe sont absentes et sur une autre, sa tête manque au tableau. Alors que les paysages sont nets et vivants, Morrissette apparaît pixellisée et floue. Elle ne semble pas à sa place, malgré l'insertion intentionnelle du sujet dans l'espace. Ces pièces sans titre sont les mémoires de Morrissette, qui se rappelle l’époque où elle vivait à Thunder Bay, en Ontario, pendant laquelle ces clichés ont été capturés. Une habituée de l'escalade et de la randonnée, elle contemplait alors sa place en tant que personne autochtone vivant sur un territoire autochtone différent. Cette série de photographies sans titre est pour Morissette la matérialisation de pensées et d’expériences dans une représentation visuelle; elle ouvre la voie à une exploration plus poussée de la création artistique et de l'environnement naturel.
Entre 2014 et 2016, Morrissette a travaillé sur la série score for bottom of a lake, qui comprend des aquarelles sur papier ainsi qu'une pièce vidéo en boucle accompagnée de l'audio d'un hydrophone conçu par l’artiste. Comme le souligne Morrissette, ces pièces sont une réflexion sur la réalisation d'un portrait de l'invisible. Les œuvres vidéo scrutent le fond rocheux d'un lac, sujet particulièrement captivant, dont la trame sonore rompt avec le doux clapotis habituel de l'eau. Le son capté par les microphones artisanaux de Morrissette est au mieux étouffé, comme s'il avait été capturé de l'intérieur d'un canot rembourré plutôt que d'un microphone suspendu dans de l'huile d'olive. En fait, il a été enregistré alors qu'elle pagayait sur les rives du nord du Michigan dans le cadre d'une résidence d'artiste en collctif et consacrée à la discussion de l'histoire, du présent et de l'avenir des autochtones sur des terres privées.[1] À la même époque, Morrissette avait séjourné à Grand Rapids, au Manitoba, un endroit dont le nom évoque le son de ses eaux avant que l'installation d'une centrale hydroélectrique par Manitoba Hydro, entre 1960 et 1968, ne le transforme, lui et les communautés environnantes. Bien qu'il ne s'agisse pas de sa communauté d'origine, Morrissette est entrée en contact avec l'aîné Ron Cook de la Nation crie de Misipawistik, qui l'a aidée dans sa réflexion sur la résilience du son de l'eau. En écoutant les sons qui ne sont plus perceptibles à l’oreille, qui ne sont plus dans leur état d’origine, Morrissette comprend comment le processus de création de cette œuvre d'art sert de métaphore pour « le récit des histoires violentes du colonialisme qui ont été recouvertes de récits de progrès, mais aussi pour décrire la résilience des communautés autochtones qui, comme l'eau, n'ont pas été réduites au silence ».
Depuis, Morrissette a commencé à s'interroger sur le rôle qu'elle joue derrière l'objectif ou le microphone, et en tant qu'artiste ou auteure de ces œuvres, elle qui « parle à proximité[2] » de ces représentations de l'histoire et du lieu. Les installations vidéo one and the same (2016) et poplar (2021) ont toutes deux invité les spectateurs à interagir avec l'œuvre d'art et à participer de manière variable à l'acte de représentation. Dans one and the same, le mouvement du spectateur devant un grand écran affecte le mouvement sur l'écran de roseaux dorés se balançant. Dans poplar, c'est lorsque le spectateur cesse de bouger que le son du vent reprend son cours dans les feuilles des branches de peuplier projetées sur le mur de la galerie. Au fil des décennies et des œuvres accumulées, un fil conducteur sous-tend la pratique de Morrissette : le rôle de la présence du corps, qu'il s'agisse du sien ou de celui de son public, en relation avec le paysage et l'environnement. Son œuvre la plus récente, listening devices, offre une ponctuation à ce fil de pensée; elle offre aussi un aperçu de ce qui nous attend dans les décennies à venir et de la manière dont l'œuvre et les idées de Morrissette se traduiront dans l'avenir.
[1] Parmi les autres artistes présents figuraient Dylan Miner, Julie Nagam et Nicholas Brown, dans le cadre du programme de résidence de Rabbit Island en 2014.
[2] Dans son film Reassemblage (1982), Trinh T. Minh-ha, cinéaste d’origine vietnamienne, décrit sa relation avec ce que certains ont appelé une « anti-ethnographie », qui résiste à l'envie documentaire de parler pour un sujet et choisit plutôt d’en parler « à proximité ».
Balsom, Erika. 2018. ’There is no Such Thing as Documentary’: An Interview with Trinh T. Minh-ha. Frieze. https://www.frieze.com/article/there-no-such-thing-documentary-interview-trinh-t-minh-ha Consulté le 5 avril 2022.
________________________________________________________________________________________
okāwīsimāk nawac kwayask itōtamwak|
Les tantes sont les meilleures
Les tantes sont les meilleures
Michelle Sound
8 janvier - 5 mars 2022



Les tantes sont les meilleures
Jas M. Morgan
L’artiste crie Michelle Sound sait que les tantes sont les meilleures. Dans son œuvre, NDN Aunties, je vois des tantes cries se tenant droites et fières. Elles sont habillées de franges et de cuir clouté, de fausse fourrure et de denim. Elles versent la tête vers l’arrière et créent des souverainetés sonores avec leurs rires qui remplissent les espaces et les crevasses du cœur de leurs nièces, neveux et autres petits qui les entourent. Je vois des tantes qui conduisent des camions sur des chemins de terre, des tantes qui portent des lunettes de soleil, des tantes qui aiment le métal et des tantes qui soutiennent leur communauté où qu’elles soient dans le monde. Je constate, debout devant les tambours de différentes tailles qui composent NDN Aunties, que chacun semble représenter une tante unique et solitaire, comme une icône de style si cool, comme des portraits matériels qui déconstruisent complètement l’esthétique et les critères coloniaux qui définissent le portrait « classique ». Un tambour est recouvert de fausse fourrure imprimée de guépard et j’imagine une tante style Reine de la Rez portant un long manteau coupé dans la même matière. Les détails des boutons d’un tambour en denim révèlent une épingle en médaillon perlé représentant une roue de médecine (j’imagine qu’elle a été fabriquée pour la tante que le tambour représente, par quelqu’un qui l’aime profondément et qui lui est reconnaissant de son soutien) et d’autres épingles représentant des langues autochtones ou affichant à quel point les tantes sont magiques. Les boutons évoquent toutes les tantes qui sont aux premières lignes des mouvements de justice autochtone. Ils me rappellent tout ce que nos tantes ont enduré aux mains d’une nation qui cherchait à les éliminer par des politiques sexistes et des violences personnelles. Ils me rappellent aussi que malgré ces tentatives d’arrachement à la terre et à la vie en communauté, l’amour et la lumière que ces tantes émettent dans toute leur communauté persistent. Ensemble, les tambours sont une force à honorer et à vénérer. Les tambours vous enveloppent. Les tambours sont beaux, mais injouables, à l’image des femmes autochtones coriaces qui ont inspiré l’œuvre de Sound.
Il ne fait aucun doute que ce qui rend les tantes autochtones si cool, ce sont les systèmes de connaissances de leurs communautés et de leurs ancêtres; ces facettes du peuple cri sont également représentées dans l’œuvre de Sound. Dans HBC Trapline, des peaux de castor accompagnent des tambours en fourrure de lapin teints aux couleurs de la couverture à quatre bandes de la Compagnie de la Baie d’Hudson : bleu, jaune, rouge et vert. Sound fait référence aux tantes que nous n’aurons jamais l’occasion de rencontrer : nos ancêtres cries. Les femmes autochtones ont joué un rôle primordial dans le commerce de la fourrure au Canada, où elles ont contribué à la préparation des fourrures et des peaux. Les mêmes connaissances que les femmes autochtones utilisaient pour soutenir leurs communautés sont ancrées dans l’histoire du travail qui a produit le Canada, bien qu’elles soient rarement reconnues. Dans Chapan Snares Rabbits, Sound fait référence à une lignée de tantes cool au sein de sa propre famille. Chapan est un terme de parenté cri qui fait référence à un arrière-grand-parent. Toutefois, Chapan a une double signification et peut également désigner les descendants d’une personne. Le chapan et la kokum de Sound ont tous deux soutenu leur famille grâce aux lignes de trappage. Les tambours Chapan Snares Rabbits, teints en rose pastel, bleu et pêche, sont un hommage aux femmes qui ont subvenu aux besoins de la famille de Sound, et à qui elle doit ses connaissances culturelles et son sens de la personnalité. Le trappage et la chasse ne sont pas des domaines où les femmes autochtones sont toujours représentées comme des pourvoyeuses dans le discours colonial contemporain. Toutefois, Sound perturbe la position dégradée des femmes autochtones dans la société canadienne en faisant référence à une longue lignée de tantes qui l’ont précédée et dont les connaissances, les soins et les pratiques matérielles inébranlables ont fait de Sound celle qu’elle est aujourd’hui.
L’art de Sound est à la fois un hommage et un testament aux tantes autochtones et à leur style cool sans pareil. Toutes les tantes autochtones sont mises à l’honneur lorsque Sound illustre les femmes fortes de sa propre lignée familiale. Je vois la force de volonté, de caractère et d’amour que possède la mère de Sound dans Nimama hates fish but worked in the cannery. Je vois les histoires de tant de familles cries qui sont restées unies grâce à l’ingéniosité et à la force des tantes autochtones, comme la famille de Sound de la Première nation de Wapsewsipi (Swan River), qui s’est retrouvée déplacée de ses territoires traditionnels, mais qui s’est reconstituée en tant que peuple grâce au travail acharné de la mère de Sound. Dans les œuvres de l’artiste, je vois la force des tantes qui ont soutenu le peuple cri pendant des siècles avant que le premier homme blanc ne mette le pied dans ces régions. Je vois des tantes hilarantes, des tantes généreuses et des tantes à ne pas embêter. Je vois des royautés cries qui sculptent des mondes avec leurs intentions et leurs soins. Je vois des tantes qui portent les nations autochtones sur leur dos. Je vois des tantes qui créent des familles autochtones avec leur amour. Je vois le droit de l’existence autochtone.
asinnajaq: ivaluit / sinews / tendons
Résidence d'artiste à daphne
Soutien aux projets par le Conseil des arts de Montréal
9 mars - 16 avril 2022

asinnajaq est une conteuse. La résidence pour artistes pluridisciplinaires du daphne a débuté par un fragment de récit, au cœur duquel on suit les Inuit devant aller au sud pour recevoir des services de santé.
L’œuvre créée au cours de cette résidence fait écho à ces voyages. Autant de
liens perdus que d’autres se forment loin du cercle familial et du foyer..
Moulin à paroles - Iakoterihwatié:ni
Kaia’tanó:ron Dumoulin Bush
Sherry Farrell-Racette, commissaire
30 octobre 2021 - 18 decembre 2021

Kaia’tanó:ron Dumoulin Bush : le bavardage visuel d’un esprit agité
Moulin à paroles : personne qui bavarde à l’excès.
Le terme « moulin à paroles » est teinté d’une connotation péjorative. Il s’agit d’une étiquette souvent attribuée aux femmes (jamais aux hommes, on se demande pourquoi !) qui incarne le stéréotype de la femme qui se refuse au silence. Tente-t-elle de noyer des pensées indésirables dans une mer de paroles? Essaie-t-elle d’être visible? Entendue? Et si le bavardage tenait davantage d’un état d’esprit?
Kaia’tanó:ron Dumoulin Bush est calme et discrète. Rêveuse, elle trace des histoires à travers son œuvre visuelle, qui comprend un ensemble de peintures, sculptures, bandes dessinées et œuvres d’art commandées en rapport avec la langue, la jeunesse et les questions autochtones essentielles. Son discours interne est constitué de pensées frénétiques qui se cachent sous un calme plat.
Un ensemble de carnets de dessin bien remplis contient sa conversation visuelle, un dialogue intérieur dynamique esquissé par des lignes fluides, des couleurs intenses et des visages crispés. Le tout se veut à la fois journal intime, confessions et expérimentations.
Tout découle de ces carnets de dessin, où les idées prennent forme. Ces formes se répètent, se transforment en versions multiples de tests à petite échelle qui décollent de la page, prennent de l’ampleur jusqu’au relief, à la peinture ou aux histoires imagées. Et que dire de tout ce rose ! Kaia’tanó:ron nous fournit une explication mathématique : mère québécoise (blanc) + père mohawk (rouge) = Kaia’tanó:ron (rose). Toutefois, il ne s’agit pas du rose que l’on retrouve chez Toys ‘R Us, Barbie, les habits de ballet ou les bonbons. Ce rose est à la fois violence et célébration. Il bondit de façon explosive de ses carnets. Des images de femmes roses aux yeux écarquillés, aux bouches hurlantes et aux bras multiples sont un thème récurrent. Elles sont à nu et vulnérables. Les pages sont parsemées de dessins au plomb plus paisibles, de délicats rendus de mains et de formes naturelles.
De nombreuses influences entrent en jeu dans l’œuvre de l’artiste, notamment une solide base en illustration acquise lors de ses études au Collège Dawson, à Montréal. Pendant la réalisation de son baccalauréat en beaux-arts dans le cadre du programme Culture visuelle autochtone de l’Université OCAD, Dumoulin-Bush a participé à la Nuit Blanche de Toronto (2017) et a lancé plusieurs projets de commissariat muséal. Ses influences sont principalement des artistes de la narration dont les œuvres sont teintées d’une sombre ironie : Joseph Sanchez, John Cuneo, Mu Pan, Lauren Marx et Ruben Anton Komangapik. Son œuvre s’inscrit au sein d’une famille esthétique qui compte de plus en plus d’artistes visuels autochtones : Walter Scott, Diane Obomsawin, et surtout Michael Nicoll Yahgulanaas, l’artiste derrière Haida manga.
Le récit personnel de Kaia’tanó:ron se retrouve à plusieurs intersections : Châteauguay/Kahnawake, origine française/mohawk, en plus de la réalité trilingue et complexe du Québec. Ses illustrations sont empreintes d’une honnêteté crue et fondamentalement dépourvues de romantisme. Elles évitent de tomber dans les notes sombres du désespoir grâce à leurs couleurs vives, leur ton ironiquement humoristique et une esthétique rappelant la bande dessinée. Il y a des personnages et des motifs récurrents : la femme rose courageuse (notre héroïne), les diablotins qui font des ravages dans sa vie, les intestins qui prennent la forme de rubans, les cercles de tresses de foin d’odeur qui se transforment en cheveux, les feuilles et les cordes qui tour à tour protègent et emprisonnent.
Au-delà du récit personnel, Dumoulin Bush s’attarde aux événements de sa communauté et aux traumatismes de nature historique. Dans Doom Scrolling, une femme anxieuse est submergée par des vagues de mauvaises nouvelles provenant du minuscule téléphone qu’elle tient en main. Obey ! et God? s’opposent à l’imposition du christianisme et remettent en question les récits coloniaux épiques qui font partie de notre quotidien depuis l’enfance. John A. MacDonald’s Head évoque le renversement de la statue à l’effigie de MacDonald au cours de l’été 2020, et l’artiste nous encourage à participer à la consommation de sa chute. School Desk met en lumière le nombre croissant de tombes non identifiées retrouvées sur les sites des pensionnats à travers le pays et honore les actes de résistance qui s’y rattachent.
Pour une femme plutôt discrète, Dumoulin Bush a beaucoup à dire et personne ne pourra la réduire au silence. Malgré l’aspect personnel de son discours intérieur, il est facile de se reconnaître dans les illustrations de Dumoulin Bush. Ses récits ne lui sont pas exclusifs. Nos histoires, nos expériences et nos réactions y trouvent aussi leur place. Tous se reconnaissent dans ce chaos quotidien, et dans cet effort de gestion de la folie du présent et de guérison des traumatismes du passé. Il s’agit, ultimement, d’une célébration collective de notre résilience.
Sonia Robertson: Manitushiu-puamuna - Entre les deux mondes
Logan MacDonald, commissaire
17 jullet - 11 septembre 2021

Manitushiu-puamuna, est une nouvelle installation de l’artiste d’origines innue et écossaise Sonia Robertson qui constitue la deuxième exposition de daphne, le nouveau centre d’art autochtone autogéré à but non lucratif.
J’ai découvert le travail de Sonia en 2002, lorsqu’elle a présenté Dialogue entre elle et moi à propos de l’esprit des animaux à la galerie Skol. L’exposition représentait un véritable tour de force, créé en hommage à sa sœur Diane, récemment décédée. Sonia avait suspendu avec lyrisme des peaux de castor du plafond, créant ainsi une installation englobante, où les fourrures semblaient flotter ensemble vers le haut et l’extérieur, toutes tournées vers l’ouest. Ce geste faisait écho à ses savoirs ilnu, plus particulièrement en ce qui a trait aux esprits des animaux et à la direction que prennent leurs esprits une fois libérés. De plus, les fourrures utilisées provenaient de manteaux de fourrure recyclés, un geste conceptuel fort lié à l’histoire industrielle de ce lieu d’exposition, situé dans une ancienne fabrique de manteaux de fourrure. J’attire ici l’attention sur le travail antérieur de Sonia, car j’ai le sentiment qu’à certains égards, Manitushiu-puamuna est une exposition complémentaire, qui approfondit ces mêmes valeurs et idées, tissant le personnel avec le spirituel grâce à une réflexivité nuancée et captivante.
L’expositionManitushiu-puamuna propose une expérience immersive, en inondant la galerie d’images et de textiles. Pourtant, l’exposition se distingue aussi par sa simplicité et son accueil, puisque Sonia a créé des sentiers à l’aide de longs piliers faits de tissu d’organza blanc suspendus du plafond au sol, produisant des formes de troncs d’arbre qui évoquent une forêt. Une série de vidéos multidirectionnelles d’images éclatantes de feuilles de trembles s’agitant dans le vent sont projetées sur les douces colonnes sculpturales. Les vidéos jouent en boucle, se succédant et se répétant sur chaque épaisseur de tissu, accompagnées par le bruissement des feuilles. L’illusion de se trouver dans une forêt est à la fois efficace et intermittente, puisque la salle permet de s’y promener librement et propose un agencement de l’espace où l’ombre de chacun peut parfois venir brouiller les projections vidéo. De plus, Sonia a installé deux impressions numériques hyperchromes à grande échelle de feuilles de trembles géantes dans les deux grandes fenêtres de la galerie visibles de la rue. Les impressions sont montées pour agir comme des panneaux lumineux la nuit vus de l’extérieur. Sonia a choisi tous ces éléments de manière intentionnelle pour diverses raisons, chaque élément ayant un but précis, revêtant une signification particulière et contribuant à sa compréhension du monde.
Dès le début de l’élaboration de l’exposition, Sonia avait à cœur de créer une installation susceptible d’amener les gens à réfléchir sur les réalités inconscientes qui nous rattachent au monde des rêves et à l’au-delà. Pour Sonia, le tremble s’avère un symbole important pour établir ce lien : ses feuilles, lorsqu’elles bougent dans le vent, ont un effet visuel et sonore presque onirique, mais cette espèce d’arbre précolonial originaire d’Amérique du Nord est également importante pour les Ilnuatsh en raison de la façon dont il est récolté et de son importance dans la nature, notamment en tant que nourriture préférée des castors. Il est important de noter que les trembles et les castors abondent le long des plages de Mashteuiatsh, d’où Sonia est originaire. Sonia rassemble tous ces éléments à dessein puisqu’elle attache une importance particulière à la façon dont de multiples strates de signification peuvent résonner dans la matière et l’image.
Au fur et à mesure que le public se promène dans la salle d’exposition principale, celle-ci rappelle une forêt presque fantomatique, car le blanc émet par moments des rayons qui semblent hanter les lieux. Cette référence renvoie aux arbres comme force de vie qui ont une raison d’être, mais aussi à la vie qui côtoie la mort et la libération d’un esprit. Sonia nous invite peut-être à nous demander si nous sommes en contact avec les esprits des arbres qui étaient là avant nous. Que pouvons-nous apprendre d’eux? Le parcours mène inévitablement à un espace exigu. Dans cette salle se trouvent deux projections vidéo intimistes qui, de concert avec les vidéos des feuilles de trembles dans la salle principale, renvoient symboliquement aux quatre éléments naturels : la terre, l’air, l’eau et le feu. Dans l’une des vidéos, du sable et des vagues ne cessent de clapoter. Les vidéos de petite taille sont projetées en dessous du niveau des yeux. Elles ont chacune leur propre mur et sont toutes projetées à travers un amas de lentilles reliées par des fils sortant des murs, rappelant des bouts de branches avec des feuilles. La projection des vidéos à travers les lentilles crée un effet de remous où les images apparaissent déformées, floues et asymétriques, dont le résultat est un cinéma onirique. Regarder cette installation donne l’impression de voir à travers les yeux de quelqu’un qui rêve.
Tout au long de nos discussions pour ce projet, alors que Sonia développait ses idées, j’ai souvent été inspiré par la manière dont elle incorpore les matières, les images et les idées, toujours de façon très réfléchie, afin de contextualiser les idées qu’elle cherche à mettre en lumière. À certains moments du processus, même sans la présence de nos formidables interprètes, je nous ai sentis capables de dialoguer au-delà de nos barrières linguistiques érigées par les langues coloniales, parvenant à communiquer et à partager avec notre énergie, nos expressions, nos gestes simples et nos références matérielles. J’en parle parce que c’est une force qui appartient principalement à Sonia, qui arrive à communiquer en captant l’énergie, ce qu’elle traduit dans sa pratique. C’est quelque chose qu’elle fait de manière tout à fait intentionnelle, peut-être par intuition, en parvenant à relier spontanément des matériaux et des images de sorte à appuyer des savoirs spirituels par des concepts. De cette façon, elle fait fi de la rhétorique coloniale pour présenter des œuvres qui prennent tout leur sens sur le plan animal et naturel. Manitushiu-puamunaest un exemple de cette maîtrise.
Dès le début de l’élaboration de l’exposition, Sonia a exprimé le désir de se servir de cette plateforme pour collaborer avec les membres de la communauté autochtone de manière à les encourager et les soutenir dans leur volonté de renouer avec leurs rêves. Avec cette œuvre, je crois que Sonia voulait illustrer comment l’héritage culturel de nombreuses communautés autochtones comprend le partage traditionnel de la signification des rêves et des liens avec l’au-delà, autrefois très prisé, mais devenu tabou en raison de la colonisation et de l’oppression culturelle. Sonia résiste à cette tendance, en nous invitant à ouvrir nos esprits et nos âmes à cette part importante de nous-mêmes et de nos origines — et à nous réfléchir sur la valeur de cette facette de nos vies. Que pouvons-nous apprendre? Comment pouvons-nous être meilleurs? Comment pouvons-nous nous connecter au-delà de nos propres réalités? En découvrant le travail de Sonia au fur et à mesure que nous développions cette exposition, j’ai constaté à quel point Sonia est engagée à soutenir la communauté et à travailler avec elle. Cela m’a permis de comprendre les intentions et les motivations artistiques profondes de Sonia, qui, selon moi, sont indissociables de ses valeurs personnelles, ancrées dans le respect et la reconnaissance de la terre, de la nature, de nous-mêmes, de nos âmes et de la communauté. C’est d’autant plus dommage qu’en raison des contraintes de distanciation sociale liées à la pandémie, le projet ne puisse pas facilement inclure un volet de participation communautaire — mais il s’agissait néanmoins d’une intention centrale qui a fait avancer le projet. Cette exposition est devenue en quelque sorte un message de Sonia qui invite chacun à rêver.
Ilnu de Mashteuiatsh où elle vit actuellement, Sonia Robertson est artiste, art thérapeute, commissaire et entrepreneure. Bachelière en art interdisciplinaire de l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 1996, elle a participé à de nombreux évènements artistiques au Canada, en France, en Haïti, au Mexique et au Japon. Elle a développé une approche in situ et de plus en plus participative. L’art est pour elle un grand moyen d’expression et de guérison. Elle a également compléter une maîtrise en art-thérapie à l’UQAT au cours de laquelle elle a créé une approche liée à l’imaginaire des peuples chasseurs-cueilleurs.
Impliquée dans sa communauté, elle a travaillé à mettre en valeurs l’art comme moyen de prise en charge et d’expression pour les gens de sa communauté. Elle a cofondé divers organismes et évènements ; dont la Fondation Diane Robertson devenue Kamishkak’Arts qui soutient les artistes à tout niveau et utilise l’art comme levier social à travers divers projets ; les ateliers d’artistes TouT-TouT de Chicoutimi en 1995 ; Kanatukulieutsh uapikun en 2001 qui travaille à la sauvegarde et à la promotion des savoirs des Pekuakamiulnuatsh sur les plantes et le Festival de contes et légendes Atalukan en 2011.
Comme commissaire, elle travaille surtout à des projets participatifs et à long terme, situés à la frontière entre l’art et l’art-thérapie, afin de créer des liens entre les Nations. Entre autres, elle fut chargée de projet au Musée Amérindien pour l’exposition permanente participative, L’esprit du Pekuakamiulnu et pour le projet Aki Odehi en Abitibi. Les deux projets furent primés par la Société des Musées Québécois. Elle participe à divers colloques et réflexions sur l’art autochtone au Canada. Elle fut l’instigatrice et porte-parole du mouvement Idle no more au Lac St-Jean.
︎
Logan MacDonald est un artiste interdisciplinaire, commissaire d’exposition, éducateur et activiste établi au Canada qui s’intéresse aux perspectives des personnes queer, handicapées et autochtones. Il est d’ascendance européenne et mi'kmaq, et se réclame à la fois de ses origines coloniales et autochtones. Né à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, ses origines mi'kmaq maternelles sont rattachées à Elmastukwek, Ktaqamkuk, de la Première Nation Qalipu. Ses œuvres ont été exposées dans toute l’Amérique du Nord, notamment à L.A.C.E. (Los Angeles), John Connelly Presents (New York), Ace Art Inc. (Winnipeg), The Rooms (St. John’s), Articule (Montréal) et le Künstlerhaus Bethanien (Berlin). Il est actuellement vice-président du Collectif des commissaires autochtones (ICCA) et titulaire d’une chaire de recherche du Canada en art autochtone à l’Université de Waterloo.
Teharihulen Michel Savard:
Parure - Ontatia’tahchondia’tha
Hannah Claus, commissaire
8 mai - 26 juin, 2021

Regardez le parcours de l'exposition iciRegardez le conversation entre artiste et commissaire ici
Les objets au mur sont délicats, finement travaillés, démontrant un mélange de matériaux coutumiers et contemporains. Le cuivre et l’argent se côtoient sous différentes formes; des tracés métalliques s’allient avec des matières organiques pour construire des assemblages de lignes et de motifs fluides. Ces composantes disparates se mélangent les unes avec les autres pour offrir une autre façon de voir et de comprendre, comme elles l’ont toujours fait et comme elles le feront toujours. Elles parlent d’une continuation culturelle au-delà des catégories normatives occidentales. Qu’est-ce que l’art? Qu’est-ce que la beauté? D’abord, nous avons employé les coquillages, les os et les poils dans notre élaboration vestimentaire. Ensuite, les perles, l’étain et l’argent sont venus enjoliver nos parures. Maintenant, c’est au tour des cartes mères, des circuits électroniques et des câbles. Toute collision culturelle laisse après l'impact un résidu miscible qui vient s'ajouter au tout. Assimilons tout ce qui brille et qui est nouveau, pour que nous nous affichions au monde parés de nos plus beaux atours. Ainsi nous honorons les mondes qui nous entourent.
Derrière la notion de parure est le désir de rehausser l’apparence visuelle d’un habit et de mettre en valeur l’ensemble. Pour les peuples Autochtones, la décoration et l’ornementation démontrent la maîtrise des techniques et des idéaux de beauté afin d’honorer l’objet en soi. Toutefois, l’embellissement sert autant à communiquer qu’à enjoliver. Les motifs et leurs structures signalent l’ontologie, la spécificité du lieu et les liens qui unissent celui qui les porte avec ceux qui ont deux pattes et ceux qui ont quatre pattes. La tortue, un symbole éponyme pour les nations de l’est, peut indiquer à la fois un clan et une ontologie. Nous vivons et marchons sur le dos de la grande tortue. Ceci organise et encadre le rythme de nos vies. Cette image démontre le lien qui nous unit à la terre, la mémoire et les ancêtres sous nos pieds. D’autres symboles d'origine européenne sont ancrés dans le langage visuel des Wendats, tels les cœurs écossais qui se transforment en hiboux et les hausse-cols et les broches circulaires qui se transmuent en étoiles et en soleils. Ces parures mettent en valeur celle ou celui qui les porte. Elles informent celles ou ceux qui les voient d’où nous venons et où nous allons. Dans la fabrication de chacune de ces œuvres, Teharihulen transmet la culture et l’expérience des Wendats. L’assemblage des divers matériaux évoque un aspect supplémentaire: la fluidité spatiale. Les mondes naturel, minéral et plastique qui s’y trouvent, en passant par le Monde souterrain et le Monde du ciel, infusent le passé et le futur dans le présent. Ensemble, ces mondes brillent comme une constellation pour indiquer le chemin à suivre. C’est ainsi que cela a toujours été. C’est ainsi que cela se poursuit.
Le processus de « faire » nous lie aux ancêtres, aux histoires familiales, et nous arrime dans le temps.
Teharihulen est Wendat de Wendake. Il fait appel au passé pour en infuser le présent et, de là, imaginer le futur. Il est le premier à porter ce nom depuis 150 ans, lorsque l’illustre Teharihulen l’a porté. Ce dernier était un joaillier, un laceur de raquettes, un chef de guerre et un peintre. Grâce à ses autoportraits, il s’est réapproprié son image que d’autres avaient réduit à un cliché romantique en le proclamant « le Dernier des ». C’est en utilisant les outils et le langage pictural occidental que cet ancêtre a démontré le pouvoir et l’autonomie de son peuple et de sa culture. Dans l’exposition, les portraits offrent la possibilité d’échange entre les deux Teharihulen: un dialogue entre artistes, guerriers et Wendat. À travers sa pratique artistique, Teharihulen Michel Savard assume le legs de son prédécesseur en communiquant la présence continue et l’auto-détermination des Wendat. C’est autant une responsabilité qu’un héritage.
︎
Hannah Claus est une artiste visuelle d'ascendance Kanienkehá:ka et anglaise qui s’intéresse aux épistémologies Onkwehonwe et à leur manière de se déployer en tant que relations unissant le vivant. Élue à la confrérie Eiteljorg en 2019 et récipiendaire du Prix Giverny en 2020, elle est membre du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal depuis 2018 et cofondatrice de daphne, le nouveau centre d’artistes autochtone à Montréal. En 2017, Claus a agi à titre de commissaire pour Tehatikonhsatatie, une exposition des artistes visuels Kahnawakeró:non Babe et Carla Hemlock. En tant que membre du Collectif des commissaires autochtones, Claus a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet Tiohtià:ke en 2018, une programmation d’expositions sur un an qui a eu lieu à Montréal et ses environs. Claus est membre de la communauté de Kenhtè:ke de Tyendinaga - Mohawks de la Baie de Quinte. Ayant grandi loin de la communauté de son grand-père, elle chérit le fait de vivre et de travailler en territoire Kanien’kehá:ka, à Tiohtià:ke [Montréal].
Ludovic Boney
Constructive Interference
Hannah Claus & Nadia Myre, commissairespresentée par daphne avec imagineNATIVE à la A Space Gallery, Toronto
Du 24 septembre 2019 au 2 novembre 2019
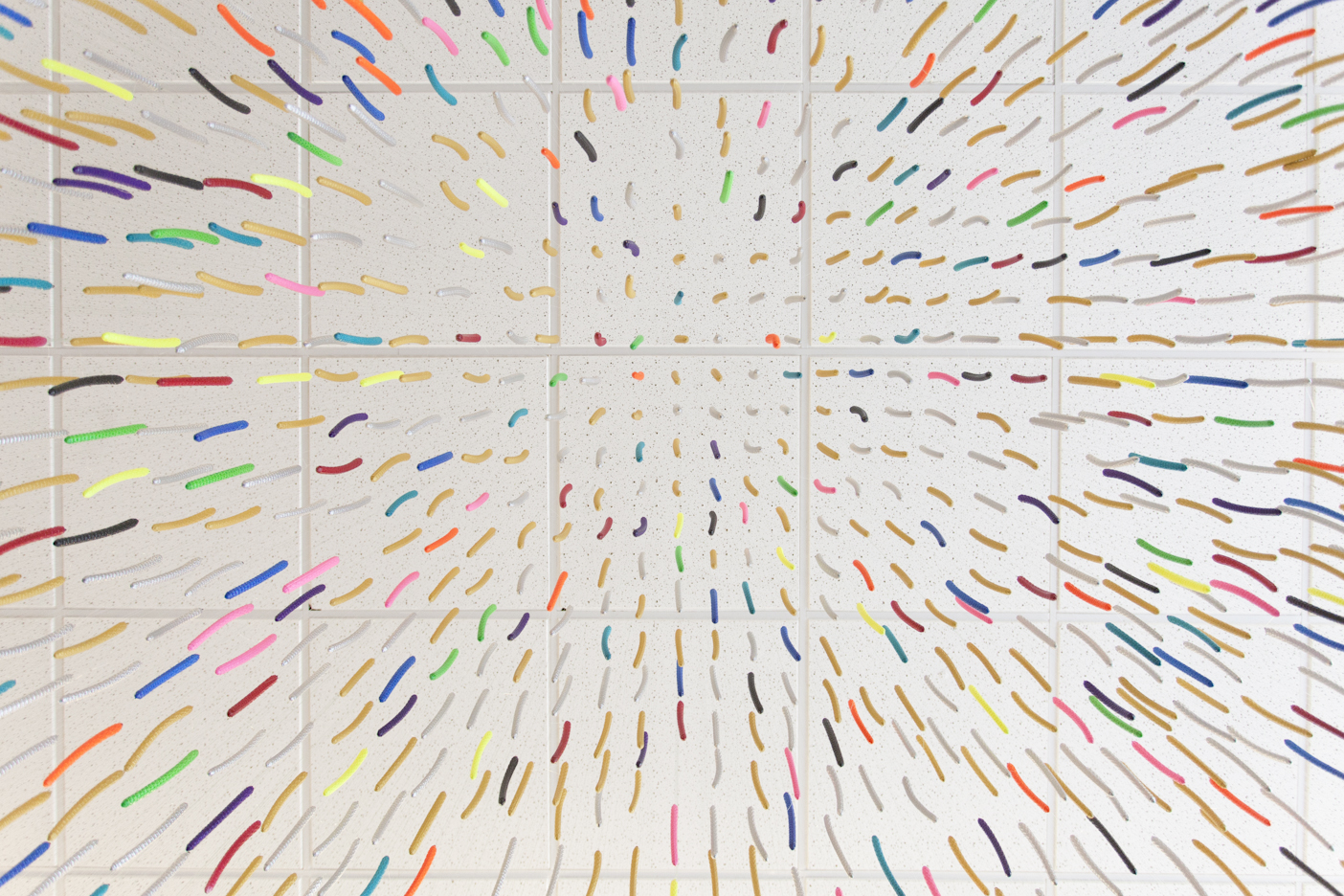


Le terme « interférence
constructive » décrit l’effet d’une source qui émet des impulsions d’énergie
amplifiant, dans son sillon, les vagues et les ondulations, qu’il s’agisse d’eau
ou de son. Dans l’exposition Constructive Interference, les
installations de Ludovic Boney amplifient l’effet de nos corps dans les espaces
qu’il a créés. Par extension, nous pouvons réfléchir aux affects de nos actions
et de nos réactions, et à la manière dont ils se répercutent à la fois sur le
plan individuel et social. Boney attire ainsi notre attention, nos mouvements
et nos corps à travers ses installations pour révéler comment des fragments
passagers se raccordent à des symphonies constituées d’expériences éphémères.
Ancrée dans la mémoire, l’installation Afin d’éviter tous ces noeuds s’inspire des interactions entre l’artiste et sa mère, qui, chaque fois qu’elle donne quelque chose à son fils, le fait en récupérant l’un des sacs en plastique bon marché qu’elle a sous la main, mais conclut toujours son geste en attachant le sac par un double nœud. Ces sacs en plastique sont noués de façon tellement serrée que Ludovic doit ensuite les déchirer pour récupérer ce qu’ils contiennent. Ce rituel entre mère et fils évoque la valeur des cadeaux et des biens, le plaisir de donner et de recevoir, mais aussi la légère frustration de devoir accepter les manies de cette routine. Dans le cadre de l’installation, l’artiste récupère et traduit ces liens, ces paquets, ces sacs, à force de découpage minutieux pour les dépouiller de leurs artifices et ainsi révéler leur peau de plastique omniprésente, tant sur le plan physique qu’esthétique.
Une tranche de paysage fabriqué: maintenues au-dessus du sol, trente à cinquante planches d’épinette sont déposées pour former un sentier qui remplit la galerie, sans toutefois avoir un début ou une fin précise. L’intérêt ne se situe pas dans la destination, mais bien dans l’expérience. De chaque côté du sentier, des milliers de fines tiges de métal, d’une hauteur de six pieds et ornementées de fragments de sacs de plastique récupérés, parsemant la surface du bois. Les logos colorés des sacs évoquent des fleurs étranges, des quenouilles ou encore des drapeaux de régate.
L’installation se veut sculpturale dans sa matérialité. Les épaisses planches de bois rappellent l’histoire et la civilisation en offrant une transition visuelle à travers la hiérarchie qui sépare les matières que sont le bois, le métal et le plastique. Toutefois, la structure s’éveille réellement lorsque le public s’aventure dans le sentier que l’artiste a préparé à cet effet. En y pénétrant, les planches craquent et fléchissent sous le poids des corps. Le champ de tiges et de formes de plastique se remue et frémit à chaque pas, entraînant une mouvance depuis la source de l’assemblage. Boney déstabilise ainsi son public avec son installation en le surélevant et le transportant à l’extérieur du lieu physique pour l’amener dans un espace sensoriel et phonique. Une fois arrivé au milieu du paysage de l’installation, un paysage sonore enregistré se fait entendre pour se lier à l’expérience physique immédiate du lieu. Cette extension phonique, créée en enregistrant et en déformant des fragments de son contenu dans les matériaux de l’installation, sert à révéler et à encadrer la réalité, nous rappelant le chaos que peut générer un simple pas.
Sous les chatons a remporté le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec — Œuvre de l’année en 2018 dans la région Chaudière-Appalaches au Québec. La création se compose de 5000 chatons de bouleau (les fleurs du bouleau) coulés en céramique, chacun peint d’une couleur vive et suspendu à des dalles au plafond qui ressemblent à celles que l’on retrouve dans des bureaux. Au sol se trouve une couronne de conifères avec son odeur de sapin frais qui imprègne les lieux. Au-delà de l’effet vertigineux créé par la surabondance de couleurs qui, de loin, peuvent s’apparenter à une nuée d’insectes immobiles, à une topologie de nuages ou encore à une topographie flottante inversée, ces cosses de graines dansantes attachées à un plafond de bureau sont à la fois apaisantes, envoûtantes et ridicules. L’installation séduit par son caractère ludique, ses matières riches et la multiplicité de ses possibles interprétations, nous menant à nous demander comment un arbre aussi fascinant a réussi à voir le jour dans une galerie d’art ou encore dans un cube blanc ou, plutôt, si nous vivons dans un avenir sans bouleaux et avons inventé ce à quoi doivent ressembler ses fruits. Ou est-ce tout simplement une occasion pour nous de célébrer l’impérissable faculté d’adaptation de notre intelligence? Ces cosses, qui virevoltent sur des rythmes célestes, tournoyant tels des rubans de soie, comme lors de la danse du châle, expriment notre survivance comme peuples autochtones, tandis que la couronne fait office d’oreiller où déposer nos têtes, nous permettant de nous rassembler et songer à la vie qui poursuit son cours.
Boney aime prendre des expériences disparates et les fusionner. Son intérêt se situe dans la création de moments absurdes, mais transcendants aptes à nous faire vivre un moment d’altérité; une hyper conscience de la façon dont nous avons construit notre monde (à la fois physiquement et intellectuellement) alors que nous sommes forcés, avec nos corps, de nous frayer un chemin dans ses créations spatiales. En parallèle, il s’intéresse à la reproduction et à la substitution, à la métamorphose et au déplacement des matériaux pour créer du sens. Sa motivation tient à la magie transformatrice du pragmatisme, à l’ici et maintenant, comme nous l’avons toujours fait, en tant que personnes, nations et cultures qui perdurent. Par-dessus tout, Boney accorde une place centrale à l’étonnement pour ce monde dans notre expérience humaine. Il est animé par la beauté et l’émerveillement que suscite le monde naturel et prend plaisir à observer ces choses: les quenouilles qui se balancent dans le vent, les chatons qui dansent dans les arbres. Cependant, en substituant le naturel par le fabriqué, Constructive Interference oppose le monde que nous avons créé à celui qui a été créé pour nous, incorporant nos préoccupations quant à l’avenir dans une célébration joyeuse et nous incitant à nous interroger sur la possibilité de réconcilier nos deux mondes.
Sculpteur originaire de Wendake, Ludovic Boney a réalisé une vingtaine de projets d’intégration à l’architecture sur le territoire québécois, dont plusieurs projets d’art public de grande envergure. En 2017, il a été nommé pour un prix Sobey et a été récipiendaire du Prix en art autochtone REVEAL. Aujourd’hui installé à Saint-Romuald, Boney continue de se consacrer à sa pratique en studio et à des projets d’art public; il présente régulièrement son travail dans des galeries et centres d’artistes au Québec et au Canada. Ludovic Boney est également enseignant de sculpture à la Maison des Métiers d’Art de Québec. Cette exposition solo est la première de Boney à l’extérieur du Québec.
︎
Hannah Claus et Nadia Myre sont des artistes professionnelles établies à Tiohtià:ke / Mooniyang / Montréal. De pair avec les artistes et commissaires Caroline Monnet et Skawennati, elles ont cofondé daphne en 2019 avec le mandat de favoriser la visibilité et la compréhension de l’art autochtone contemporain au Québec. Cela inclut la promotion des artistes autochtones basés au Québec à l’intérieur et à l’extérieur de la province. Constructive Interference est le projet inaugural de daphne en matière de commissariat.
Ancrée dans la mémoire, l’installation Afin d’éviter tous ces noeuds s’inspire des interactions entre l’artiste et sa mère, qui, chaque fois qu’elle donne quelque chose à son fils, le fait en récupérant l’un des sacs en plastique bon marché qu’elle a sous la main, mais conclut toujours son geste en attachant le sac par un double nœud. Ces sacs en plastique sont noués de façon tellement serrée que Ludovic doit ensuite les déchirer pour récupérer ce qu’ils contiennent. Ce rituel entre mère et fils évoque la valeur des cadeaux et des biens, le plaisir de donner et de recevoir, mais aussi la légère frustration de devoir accepter les manies de cette routine. Dans le cadre de l’installation, l’artiste récupère et traduit ces liens, ces paquets, ces sacs, à force de découpage minutieux pour les dépouiller de leurs artifices et ainsi révéler leur peau de plastique omniprésente, tant sur le plan physique qu’esthétique.
Une tranche de paysage fabriqué: maintenues au-dessus du sol, trente à cinquante planches d’épinette sont déposées pour former un sentier qui remplit la galerie, sans toutefois avoir un début ou une fin précise. L’intérêt ne se situe pas dans la destination, mais bien dans l’expérience. De chaque côté du sentier, des milliers de fines tiges de métal, d’une hauteur de six pieds et ornementées de fragments de sacs de plastique récupérés, parsemant la surface du bois. Les logos colorés des sacs évoquent des fleurs étranges, des quenouilles ou encore des drapeaux de régate.
L’installation se veut sculpturale dans sa matérialité. Les épaisses planches de bois rappellent l’histoire et la civilisation en offrant une transition visuelle à travers la hiérarchie qui sépare les matières que sont le bois, le métal et le plastique. Toutefois, la structure s’éveille réellement lorsque le public s’aventure dans le sentier que l’artiste a préparé à cet effet. En y pénétrant, les planches craquent et fléchissent sous le poids des corps. Le champ de tiges et de formes de plastique se remue et frémit à chaque pas, entraînant une mouvance depuis la source de l’assemblage. Boney déstabilise ainsi son public avec son installation en le surélevant et le transportant à l’extérieur du lieu physique pour l’amener dans un espace sensoriel et phonique. Une fois arrivé au milieu du paysage de l’installation, un paysage sonore enregistré se fait entendre pour se lier à l’expérience physique immédiate du lieu. Cette extension phonique, créée en enregistrant et en déformant des fragments de son contenu dans les matériaux de l’installation, sert à révéler et à encadrer la réalité, nous rappelant le chaos que peut générer un simple pas.
Sous les chatons a remporté le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec — Œuvre de l’année en 2018 dans la région Chaudière-Appalaches au Québec. La création se compose de 5000 chatons de bouleau (les fleurs du bouleau) coulés en céramique, chacun peint d’une couleur vive et suspendu à des dalles au plafond qui ressemblent à celles que l’on retrouve dans des bureaux. Au sol se trouve une couronne de conifères avec son odeur de sapin frais qui imprègne les lieux. Au-delà de l’effet vertigineux créé par la surabondance de couleurs qui, de loin, peuvent s’apparenter à une nuée d’insectes immobiles, à une topologie de nuages ou encore à une topographie flottante inversée, ces cosses de graines dansantes attachées à un plafond de bureau sont à la fois apaisantes, envoûtantes et ridicules. L’installation séduit par son caractère ludique, ses matières riches et la multiplicité de ses possibles interprétations, nous menant à nous demander comment un arbre aussi fascinant a réussi à voir le jour dans une galerie d’art ou encore dans un cube blanc ou, plutôt, si nous vivons dans un avenir sans bouleaux et avons inventé ce à quoi doivent ressembler ses fruits. Ou est-ce tout simplement une occasion pour nous de célébrer l’impérissable faculté d’adaptation de notre intelligence? Ces cosses, qui virevoltent sur des rythmes célestes, tournoyant tels des rubans de soie, comme lors de la danse du châle, expriment notre survivance comme peuples autochtones, tandis que la couronne fait office d’oreiller où déposer nos têtes, nous permettant de nous rassembler et songer à la vie qui poursuit son cours.
Boney aime prendre des expériences disparates et les fusionner. Son intérêt se situe dans la création de moments absurdes, mais transcendants aptes à nous faire vivre un moment d’altérité; une hyper conscience de la façon dont nous avons construit notre monde (à la fois physiquement et intellectuellement) alors que nous sommes forcés, avec nos corps, de nous frayer un chemin dans ses créations spatiales. En parallèle, il s’intéresse à la reproduction et à la substitution, à la métamorphose et au déplacement des matériaux pour créer du sens. Sa motivation tient à la magie transformatrice du pragmatisme, à l’ici et maintenant, comme nous l’avons toujours fait, en tant que personnes, nations et cultures qui perdurent. Par-dessus tout, Boney accorde une place centrale à l’étonnement pour ce monde dans notre expérience humaine. Il est animé par la beauté et l’émerveillement que suscite le monde naturel et prend plaisir à observer ces choses: les quenouilles qui se balancent dans le vent, les chatons qui dansent dans les arbres. Cependant, en substituant le naturel par le fabriqué, Constructive Interference oppose le monde que nous avons créé à celui qui a été créé pour nous, incorporant nos préoccupations quant à l’avenir dans une célébration joyeuse et nous incitant à nous interroger sur la possibilité de réconcilier nos deux mondes.
Sculpteur originaire de Wendake, Ludovic Boney a réalisé une vingtaine de projets d’intégration à l’architecture sur le territoire québécois, dont plusieurs projets d’art public de grande envergure. En 2017, il a été nommé pour un prix Sobey et a été récipiendaire du Prix en art autochtone REVEAL. Aujourd’hui installé à Saint-Romuald, Boney continue de se consacrer à sa pratique en studio et à des projets d’art public; il présente régulièrement son travail dans des galeries et centres d’artistes au Québec et au Canada. Ludovic Boney est également enseignant de sculpture à la Maison des Métiers d’Art de Québec. Cette exposition solo est la première de Boney à l’extérieur du Québec.
︎
Hannah Claus et Nadia Myre sont des artistes professionnelles établies à Tiohtià:ke / Mooniyang / Montréal. De pair avec les artistes et commissaires Caroline Monnet et Skawennati, elles ont cofondé daphne en 2019 avec le mandat de favoriser la visibilité et la compréhension de l’art autochtone contemporain au Québec. Cela inclut la promotion des artistes autochtones basés au Québec à l’intérieur et à l’extérieur de la province. Constructive Interference est le projet inaugural de daphne en matière de commissariat.
Les activités de daphne ont lieu en territoires non cédés. C’est avec fierté que nous participons à la vie de cette île appelée Tiohtià:ke par les Kanien’kehá:ka et Mooniyang par les Anishinaabe alors que ce territoire urbain continue de représenter un lieu de rassemblement florissant pour les peuples, à la fois autochtones et allochtones.
︎︎
conception du site par Sébastien Aubin.
